
Taiwan
Capitale: Taipei
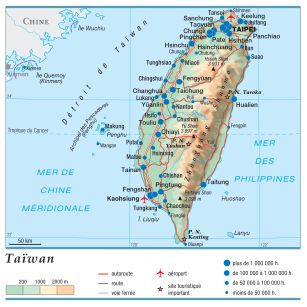
Nom officiel: Taiwan
Population: 23 359 928 habitants (est. 2014) (rang dans le monde: 51)
Superficie: 3 980 km. car.
Système politique: république; démocratie multipartite
Capitale: Taipei
Monnaie: nouveau dollar taiwanais
PIB (per capita): 39 600$ US (2013)
Langues: chinois mandarin (langue officielle), taiwanais (min), dialectes hakka
Religions: mélange de bouddhisme et de taoisme 93%, chrétiens 4.5%, autres 2.5%
GÉOGRAPHIE
Taïwan constitue une province de la Chine. Depuis 1949, elle est administrée de fait, sous le nom de République de Chine, par son propre gouvernement.
L'île, traversée par le tropique et abondamment
arrosée par la mousson en été, est formée, à l'est, de montagnes élevées
et, à l'ouest, de collines et de plaines intensément mises en valeur
(canne à sucre, riz, légumes et fruits). Le secteur industriel
(textiles, matériel électrique et électronique, plastiques, jouets), à
vocation exportatrice, est devenu le moteur d'une économie qui a connu
un essor spectaculaire.
1. Le milieu naturel

2. La population
À l'origine, l'île de Taïwan était essentiellement peuplée de Paléomongoloïdes, ou Proto-Malais, rattachés au sous-groupe malayo-polynésien de la vaste famille linguistique austronésienne. Aujourd'hui, cette population primitive vit dans les régions montagneuses de l'île. Depuis une dizaine d'années, elle revendique avec force son identité culturelle et linguistique, et réclame la restitution de ses terres. Sa lutte rejoint d'ailleurs le combat plus général, engagé par l'ensemble des insulaires, pour la reconnaissance d'une identité taïwanaise.
Mais ces Taïwanais de souche ne représentent
actuellement que 1,6 % de la population de l'île, la majeure partie des
habitants (98 %) étant d'origine chinoise. Les premiers Chinois seraient
arrivés à Taïwan au ixe s. Pourtant, ce n'est qu'à partir du xviie s.,
sous les Qing, que la colonisation chinoise se développe réellement.
Des habitants de la province du Fujian – à laquelle Taïwan est rattachée
jusqu'en 1887 – quittent le continent pour s'installer sur l'île. En
1811, grâce à ces colons qui parlent le dialecte minnan, Taïwan compte
2 millions d'habitants. Par ailleurs, des Hakkas venus de la province de
Canton s'installent à leur tour sur l'île, constituant une nouvelle
vague de colonisation.
En 1895, après deux siècles de rattachement à la
Chine, la province de Taïwan devient une colonie japonaise. En un
demi-siècle, les Japonais réussissent à imposer leur langue et bien des
traits de leur civilisation. Mais, en 1945, Taïwan repasse aux mains des
Chinois, ce retour à la Chine entraînant l'arrivée massive de nouveaux
« continentaux » dans l'île. En effet, après la défaite du nationaliste
Jiang Jieshi (Tchang Kaï-chek) sur le continent (1949), 2 millions de
Chinois trouvent refuge à Taïwan. Ces derniers viennent s'ajouter aux
6 millions de Taïwanais occupant déjà l'île.
Actuellement, ces apports successifs ne constituent
plus un problème majeur. Le droit des minorités est reconnu et respecté.
Le minnan, persécuté du temps de Jiang Jieshi au profit du mandarin,
est aujourd'hui parlé, écrit et diffusé sur les ondes. Les colons
originaires du Fujian – soit 75 % de la population actuelle – continuent
donc à utiliser leur dialecte, mais la plupart d'entre eux connaissent
également le mandarin, appris à l'école. Les Hakkas s'expriment, eux
aussi, volontiers dans leur langue. Quant aux « continentaux », ils ne
parlent que le mandarin. Quoi qu'il en soit, tous ont de plus en plus
conscience d'une identité taïwanaise, jouissant de certaines
spécificités, dans le cadre d'une culture chinoise acceptée par tous, ou
presque.
Actuellement, Taïwan est l'un des pays qui possède la densité de population la plus élevée du monde : 600 habitants par km2 en moyenne – 1 500 habitants par km2
si l'on exclut les terres montagneuses et forestières, à peu près
désertes. Pourtant, dès les années 1950, le gouvernement a imposé une
politique de contrôle des naissances, limitant le nombre d'enfants à
deux par famille. Le niveau d'instruction est élevé, semblable à celui
du Japon ou de la Corée du Sud : l'île ne compte que 6 % d'illettrés.
Taïwan possède donc toutes les caractéristiques d'un pays développé, ce
qui fait d'elle un nouveau pays industrialisé (N.P.I.). En trois
décennies, Taïwan est ainsi devenue l'un des « dragons asiatiques ».
3. L'économie de l'après-guerre
Après la Seconde Guerre mondiale, sous l'impulsion des Américains, désireux de faire de Taïwan un « porte-avions insubmersible » face à la Chine communiste, l'île a connu de profonds bouleversements économiques. À l'instar du Japon, l'État a joué un rôle décisif dans ces réformes. Le puissant ministère du Commerce extérieur a notamment favorisé les exportations par la sous-évaluation du yuan et développé, par divers avantages, les productions nationales, pour les substituer à de coûteuses importations. L'État a également profité de la confiscation des entreprises japonaises pour assurer, en 1952, 52 % de la valeur de la production industrielle de l'île. Mais, comme dans le Japon de l'ère Meiji, une fois réalisés les principaux investissements, le gouvernement taïwanais a passé la main au secteur privé. Des conglomérats se sont développés dans l'industrie lourde – l'acier, le ciment et la pétrochimie. Ces ensembles industriels sont étroitement liés au gouvernement et à son parti, le Guomindang, à l'imitation des chaebols sud-coréens et des keiretsu japonais.
La première étape de la politique de reconstruction
économique a été la réforme agraire, réalisée entre 1951 et 1953. La
propriété a été limitée à 3 hectares pour la riziculture et 6 hectares
pour les cultures sèches, l'État rachetant le surplus aux grands
propriétaires, indemnisés par des bons du Trésor et des actions dans les
entreprises d'État. Les anciens notables ruraux ont réinvesti leurs
capitaux dans de multiples petites entreprises. Cela a permis
l'émergence d'une nouvelle classe moyenne, moderne et relativement
instruite. Quant aux 200 000 paysans, naguère fermiers de leurs terres,
ils sont devenus propriétaires de petits lopins de terre, dans
d'excellentes conditions. Grâce à ces mesures, la production agricole
s'est considérablement accrue. L'agriculture est prospère : canne à
sucre, riz, légumes et fruits, thé, complétée par la pêche et
l'aquaculture.
4. Une puissance économique mondiale
Un peu de houille et de gaz sont les seules ressources
notables du sous-sol. L'électricité est fournie pour près de moitié par
les centrales nucléaires. Le secteur industriel, fondement de la
puissance économique, importe ses matières premières et les produits de
base et exporte des produits élaborés. Il est devenu le moteur d'une
économie qui a connu un essor spectaculaire. Dominé autrefois par les
industries de main-d'œuvre (faisant de la sous-traitance pour le compte
de firmes étrangères), il concerne maintenant de plus en plus les
secteurs de la technologie de pointe. Taïwan est le troisième producteur
mondial de semi-conducteurs et le deuxième producteur mondial d'écrans
plats. Les matériels électriques et électroniques viennent en tête des
exportations, suivis par le textile, les objets de plastique et les
jouets. Le tourisme est important. Le Japon, la Chine continentale et
les États-Unis sont les principaux partenaires de Taïwan.

Le développement industriel s'est fait en trois
étapes. Durant les vingt premières années, Taïwan a favorisé
principalement l'essor des industries de main-d'œuvre. Ensuite, vers
1970, la politique s'est orientée vers le développement des industries
de capitaux à forte valeur ajoutée. Cela s'est traduit notamment par la
création de zones industrielles franches, à Kaohsiung en 1966 et à
Nanhoi en 1970. Depuis les années 1990, avec l'apparition de technopoles
vouées à la très haute technologie – au nord, le parc industriel
scientifique de Hsinchu, ouvert dès 1980, et, au sud, celui de Hsinshih,
ouvert en 1996 –, Taïwan utilise au mieux la qualité exceptionnelle de
sa main-d'œuvre. Un énorme pôle financier, boursier et aéroportuaire
– le « Centre d'opération régionale de l'Asie pacifique » – se développe
le long de l'autoroute Sun Yat-sen, dans la gigantesque conurbation
formée par Keelung, Taipei et Kaohsiung. Ces conglomérats financiers et
industriels coopèrent avec 900 000 P.M.E., qui assurent la majorité des
emplois. Ils entretiennent généralement d'étroites relations avec des
multinationales américaines, mais sont aussi en très bons termes avec le
parti démocratique progressiste. Comme souvent d'ailleurs en Asie
orientale, le politique et l'économique s'interpénètrent, ce qui
facilite le financement des entreprises, mais constitue également un
facteur de fragilité.
En effet, cette réussite repose sur le maintien de
l'actuel statu quo avec la Chine populaire – une indépendance de fait,
mais non de droit, de l'île de Taïwan –, qui rassure les investisseurs
étrangers et favorise des délocalisations rentables sur le continent.
L'avenir de Taïwan dépend donc de l'évolution de la situation politique
et des relations internationales.
HISTOIRE
L'île est colonisée par les Chinois au xiie siècle. Les Portugais, qui la découvrent en 1590, lui donnent le nom d'Ilha Formosa (Formose), mais ne peuvent s'y implanter. Plus heureux, les Hollandais fondent Anping sur la côte ouest (1624) et repoussent une tentative espagnole sur Keelung (1642). Le pirate chinois Koxinga s'empare de l'île (1661), qui devient une principauté autonome ; mais, conquise par les empereurs mandchous, l'île devient chinoise (1683). En 1860, les Occidentaux obtiennent l'ouverture de Taïwan à l'influence des missionnaires catholiques et protestants. À la suite du massacre de pêcheurs japonais échoués sur la côte (1871), un corps d'armée japonais, commandé par Saigo Tsugumichi, débarque dans le Sud (1874), puis l'évacue après versement d'une indemnité. Lors de la guerre du Tonkin, l'amiral Courbet, pour le blocus du riz, occupe Keelung, mais Lespès échoue devant Tanshui (1884). Lors de la paix de 1885, la France renonce à l'île, que les Japonais annexent par la paix de Shimonoseki (avril 1895). Durant la Seconde Guerre mondiale, ils font de Taïwan une base d'invasion. À la conférence du Caire (1943), Jiang Jieshi (Tchang Kaï-chek) se voit promettre la restitution de Taïwan, qui a lieu en septembre 1945.
Les envoyés du Guomindang,
bien accueillis à leur arrivée, se comportent comme en pays conquis,
tenant ouvertement les insulaires pour des « collaborateurs » de
l'occupant nippon ou pour des Chinois de seconde zone. De plus, ils
apportent avec eux toutes les tares qui minent le régime sur le
continent : inflation galopante, chômage massif, corruption généralisée.
En février 1947, une émeute, à Taipei, aboutit à une insurrection
générale de l'île. Le gouverneur négocie alors avec des élus de la
population qui exigent dans une certaine confusion le retrait des forces
nationalistes et une véritable autonomie. Mais des renforts militaires
envoyés du continent à partir du 5 mars se livrent pendant dix jours à
une répression impitoyable, qui sera prolongée de façon ordinaire
jusqu'en 1954 par une terreur blanche permanente. On parle en tout de
10 000 à 20 000 victimes.
La Chine nationaliste de Jiang Jieshi
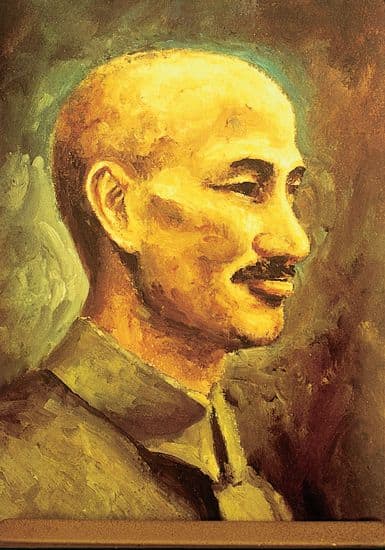
Si Jiang Jieshi et le Guomindang se maintiennent au
pouvoir lors des élections de 1972, la situation du gouvernement
nationaliste n'en est pas moins fortement modifiée à partir du moment où
les États-Unis prennent contact avec le gouvernement de Pékin. La
prétention de représenter l'ensemble de la Chine doit être abandonnée
après que l'Assemblée générale de l'ONU eut expulsé la délégation de
Taipei (25 octobre 1971). Les États-Unis reconnaissent bientôt le fait
accompli.
Après la mort de Jiang Jieshi (avril 1975), Yen
Chia-kan devient président de Taïwan, tandis que Jiang Jingguo, Premier
ministre, devient président du Guomindang. En 1978, il est élu président
de la République, détenant ainsi la majeure partie des pouvoirs. En
1979, les États-Unis reconnaissent officiellement la République
populaire de Chine et rompent leurs relations diplomatiques avec Taïwan
dont ils restent, cependant, le principal appui.
La libéralisation du régime
Le 14 juillet 1987, la levée de la loi martiale, imposée à l'île par Jiang Jieshi le 19 mai 1949, ouvre une ère nouvelle dans la vie politique de la République de Chine. Après la mort de Jiang Jingguo, le 13 janvier 1988, et la désignation comme successeur d'un Taïwanais d'origine, Lee Teng-hui, le démantèlement de l'appareil répressif du Guomindang s'accélère. Déjà, les dirigeants élus par le XIIIe congrès du Guomindang, en 1988, sont en majorité des Taïwanais et non plus des continentaux. Les opposants libéraux au régime et les partisans d'une autonomie ou d'une indépendance de l'île s'étaient organisés en une formation « hors parti » (tangwai) dès 1978, mais ils avaient connu des échecs, des divisions internes et diverses périodes de répression. En septembre 1986, le parti démocratique progressiste (Democratic Progressive Party [DPP]) affronte les élections sans succès notable, en proposant des réformes politiques libérales et l'indépendance de l'île.
Dans les années 1990-1995, cependant, la vie
politique se développe dans un climat plus libre, surtout dans le Sud,
autour de Kaohsiung. Le 28 février 1995, Lee Teng-hui présente ses
excuses officielles pour la répression de 1947, érige un monument dédié
aux victimes et fait du jour anniversaire de la tragédie une fête
chômée. Le pas décisif est franchi le 23 mars 1996, avec l'élection au
suffrage universel par 54 % des voix – la participation est de 75 % – de
Lee Teng-hui, candidat officiel du Guomindang. En perte de vitesse et
désormais amputé de ses membres restés fidèles à la thèse de la
reconquête du continent, ce dernier cherche à normaliser ses relations
avec la Chine populaire, en espérant pérenniser le statu quo qui assure à
l'île une indépendance de facto. Après les élections locales de
novembre 1997, le DPP devient le premier parti de l'île avec 43,32 % des
voix, devant le Guomindang, 42,12 %. S'étant peu à peu rallié à l'idée
du maintien du statu quo et renonçant à une indépendance formelle dont
la Chine populaire fait un casus belli, il souligne la nécessité de
réformes démocratiques de fond. En décembre 1998, le Guomindang remporte
les élections législatives et locales, avec 46,43 % des voix, mettant
fin, provisoirement, à la lente érosion de son électorat entamée depuis
plusieurs années. Le DPP enregistre, quant à lui, un léger recul, avec
29,56 % des suffrages. Les Taïwanais sont alors rassurés devant la
relative bonne résistance de leur économie emportée par la tourmente de
la crise asiatique.
« Indépendantistes » face au Guomindang : les rapports avec la Chine populaire au cœur de la politique taïwanaise

Les élections législatives de décembre 2001
confirment l'importance croissante du DPP dans le paysage politique ;
celui-ci, en obtenant 87 des 225 sièges du Parlement, devient la
première force politique du pays. La formation d'une alliance avec le
parti de la Solidarité taïwanaise (TSU, radical indépendantiste) donne
au président Chen la marge de manœuvre minimale au Parlement qui lui
faisait défaut depuis son élection en 2000. Le Guomindang, quant à lui,
pâtit d'une image ternie par des années de corruption, alors même que
les difficultés économiques rencontrées par l'île nationaliste auraient
dû lui être favorables. Mais, les électeurs ont préféré réaffirmer
clairement leur spécificité face au continent, en dépit de la forte
attraction exercée par une Chine populaire en pleine expansion (« fièvre
de Shanghai ») auprès de nombre d'hommes d'affaires taïwanais.
La posture irrédentiste de la Chine n'évolue
guère, cette dernière se bornant à éviter de mettre en avant le thème de
la force. Ainsi, la visite officielle du dalaï-lama à Taipei (avril
2001) comme le voyage « privé » aux États-Unis de Chen Shui-bian
(mai-juin) ne suscitent guère de réactions de la part de Pékin, qui, en
revanche, n'autorise pas le président à participer au sommet de l'APEC à
Shanghai. Toutefois, le projet gouvernemental d'une nouvelle
Constitution et celui visant à légaliser le recours au référendum
(novembre 2003), relèvent, selon Pékin, du séparatisme.

La courte victoire de Chen Shui-bian
lors de l'élection présidentielle du 20 mars 2004 (le président sortant
ne l'emportant que de quelques milliers de voix devant Lien Chan,
candidat du Guomindang) est vivement contestée par l'opposition qui
dénonce, en outre, le mystérieux attentat dont a été victime le chef de
l'État la veille du scrutin. Le président Chen essuie un échec dans le
double référendum organisé le même jour sur le renforcement de la
défense de l'île face à la menace des missiles chinois et sur
l'ouverture de discussions avec la Chine, invalidé faute du quorum
nécessaire. Affaibli, Chen Shui-bian infléchit sa politique quitte à
décevoir ses partisans, en réduisant la révision de la Constitution à un
amendement purement technique sans toucher à la question controversée
de l'indépendance formelle de l'île (le recours au référendum pour tout
amendement constitutionnel sera adopté en 2006 selon des modalités très
restrictives).
Le retour du Guomindang au pouvoir
Les élections législatives du 11 décembre, perdues par la coalition des indépendantistes au profit du Guomindang qui conserve la majorité au Yuan législatif, éloignent un peu plus la perspective d'un glissement progressif vers l'indépendance. Quelques semaines après l'adoption par l'Assemblée nationale chinoise d'une loi antisécession légitimant le recours à la force contre Taïwan si celle-ci proclamait son indépendance, la visite officielle et historique du leader du Guomindang, Lien Chan, à Pékin le 29 avril 2005, au cours de laquelle sont signés plusieurs accords visant à une réunification de l'île sous forme de province autonome, embarrasse le président Chen. La défaite du DPP aux élections régionales du 3 décembre 2005 puis les accusations de corruption éclaboussant l'entourage présidentiel entraînent une brutale désaffection des Taïwanais envers leur président (qui sera finalement condamné à la prison à vie pour détournement de fonds, blanchiment, faux en écriture et corruption en 2009), plus de la moitié estimant qu'il devrait démissionner. Son parti, le DPP, désavoué par une part croissante de son électorat qui lui reproche sa remise en cause récurrente du statu quo dans les relations avec la Chine (campagne de « détchankaïtchekisation ») et l'aggravation de l'isolement international de l'île (comme en témoigne, notamment, la rupture des relations diplomatiques décidée par le Costa Rica en juin 2007), est sévèrement battu aux élections législatives du 12 janvier 2008 par le Guomindang, qui enlève 83 sièges (sur 113) au Yuan. La victoire du candidat de l'opposition, Ma Ying-jeou (58,4 % des voix), devant le candidat du DPP, Frank Hsieh (41,5 %), lors du scrutin présidentiel du 22 mars, consacre le retour au pouvoir du Guomindang.
Le rapprochement avec la Chine se déroule dès lors en
plusieurs étapes : en novembre 2008, lors d’une rencontre historique
depuis la fin de la guerre entre communistes et nationalistes chinois il
y a 60 ans, le président taïwanais reçoit Chen Yunlin, responsable
chinois du département des relations entre la Chine populaire et Taïwan.
Le mois suivant, premier signe concret du réchauffement des relations
entre les deux pays, la Chine et Taïwan inaugurent leurs premières
liaisons aériennes directes quotidiennes et des services maritimes et
postaux directs à travers le détroit sont établis. Enfin, couronnement
de ce rapprochement, un accord-cadre de coopération économique (ECFA)
libéralisant les échanges commerciaux entre les deux pays (suppression
ou réduction des taxes sur des centaines de produits) est signé en juin
2010 et entre en vigueur en septembre.
En janvier 2012, le président sortant Ma Ying-jeou
est réélu pour un second mandat tandis que le Guomindang remporte les
élections législatives. Un nouveau gouvernement dirigé par Sean Chen
entre en fonctions. Investi en mai, le président veut poursuivre la
politique de rapprochement pacifique avec la Chine populaire dans le
cadre du statu quo (défini par les formules « pas d’unification, pas
d’indépendance et pas de recours à la force » et d’« Une République de
Chine, deux régions ») alors que Taïwan est désormais le premier
investisseur étranger en Chine continentale, devenue son premier
partenaire commercial.
En témoigne ainsi l’échange de bureaux entre
l’Association pour les relations à travers le détroit de Taiwan (ARATS)
pour Pékin, et la Fondation des échanges entre les deux rives (SEF) pour
Taipei. Dans le même temps, il engage son gouvernement à accélérer les
mesures de libéralisation commerciale afin de créer un environnement
propice à l’adhésion de l’île au Partenariat Trans-Pacifique (TPP)
proposé par les États-Unis et visant la création d’une vaste zone de
libre-échange à l’horizon 2015, un projet vu avec méfiance par Pékin qui
prône de son côté la constitution d’un espace économique avec la Corée
du Sud et le Japon.

0 commentaires:
Enregistrer un commentaire