
La Tanzanie
Capitale: Dar Es Salaam
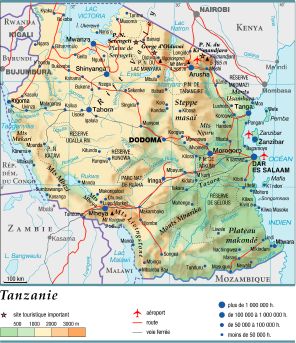
Nom officiel: Républioque-unie de Tanzanie
Population: 49 639 138 habitants (est. 2014) (rang dans le monde: 30)
Superficie: 945 087 km. car.
Système politique: république
Capitale: Dar Es Salaam
Monnaie: shilling tanzanien
PIB (per capita): 1 700$ US (est. 2013)
Langues: swahili (ou kiswahili langue officielle), kiunguja (nom du swahili à Zanzibar), anglais (langue officielle), arabe (largement parlé à Zanzibar), plusieurs langues locales
Religions: chrétiens 30%, musulmans 35%, croyances indigènes 35%; Zanzibar: musulmans à plus de 99%
GÉOGRAPHIE
La partie continentale de l'État (l'ancien Tanganyika) est formée d'une plaine côtière, limitée par un vaste plateau coupé de fossés d'effondrement et dominé par de hauts massifs volcaniques (Kilimandjaro). L'élevage (bovins surtout) et les cultures vivrières (manioc, maïs) sont complétés par des cultures commerciales (café, coton, sisal, thé, noix de cajou, clous de girofle des îles de Zanzibar et de Pemba). L’exploitation des ressources minières (or surtout, diamants, étain) et le tourisme se développent. Mais les échanges sont déficitaires et le pays est très endetté. La population, qui augmente rapidement, est formée majoritairement de groupes bantous et se partage entre chrétiens, musulmans et animistes.1. Le milieu naturel

Le pays est formé de la Tanzanie continentale (ancien
Tanganyika) et de la Tanzanie insulaire (ancien État de Zanzibar).
Ceinturé à l'ouest et au sud-ouest par l'arc occidental des rifts de
l'Afrique orientale, où se logent les lacs Tanganyika, Rukwa et Malawi,
il est traversé en son centre par l'arc oriental, moins spectaculaire et
plus discontinu, occupé par les lacs Natron, Manyara et Eyasi. La
formation de ces fossés tectoniques a entraîné des épanchements
volcaniques, les plus importants se situant au nord-est, avec le
Kilimandjaro (5 895 m), point culminant du continent africain, et la
caldeira du Ngorongoro, l'une des plus vastes du monde. Entre les rifts,
un immense plateau s'abaisse au nord vers la cuvette du lac Victoria,
accidenté au sud et à l'est par une série de monts (Livingstone,
Uluguru, Nguru, Usambara) ; il domine les basses terres sédimentaires,
bordées par la côte lagunaire de l'océan Indien, frangée de coraux,
échancrée par des rias qui facilitent l'implantation des ports. Au large
se situent plusieurs îles coralliennes, dont les plus importantes sont
Mafia, Pemba et Zanzibar (les deux dernières formant la Tanzanie
insulaire).

Partagée entre les bassins hydrographiques de trois
grands fleuves, le Nil, le Congo et le Zambèze, la Tanzanie possède, en
outre, les bassins endoréiques des lacs Natron, Manyara, Eyasi et Rukwa.
Le climat chaud, aux amplitudes diurnes fortes à l'intérieur, est
relativement sec, aride dans les steppes Masais et sur les plateaux du
Nord-Est ; il est plus humide sur la côte (700 à 1 100 mm), dans les
îles (1 500 mm) et dans le reste du pays (700 à 2 000 mm) suivant le
relief et l'exposition aux vents humides. De graves sécheresses
saisonnières influencent le réseau hydrographique, en partie à sec
durant une période de l'année. L'irrégularité des pluies est un des
handicaps de l'agriculture. Les paysages sont très variés, depuis la
côte (mangrove et cocoteraies) jusqu'à la végétation étagée des
montagnes, en passant par la forêt claire (le miombo) de l'ouest
des plateaux et la steppe à acacia. Cette flore est peuplée par une
faune abondante qui fait le charme des réserves, dont la plus importante
est formée, au nord, par le parc national du Serengeti.
2. La population et l'économie
Les Tanzaniens sont d'origine assez diverse : aux
petits groupes pygmoïdes sont venues successivement s'ajouter des
peuples bantous, aujourd'hui prédominants, puis nilotiques, ainsi que
des immigrants arabes et indiens. Il reste des Pygmées (apparentés aux
Bochimans) autour du lac Eyasi. Parmi les peuples bantous les plus
importants, les Sukumas peuplent les abords du lac Victoria, les Chaggas
les pentes du Kilimandjaro, les Nyamwezis la région de Tabora, et les
Makondés (matrilinéaires) le sud du pays, sur les deux rives de la
Ruvuma. Les Masais, peuple nilotique, sont implantés dans le Nord, de
part et d'autre de la frontière avec le Kenya. Les immigrants arabes
(qui dominaient jadis à Zanzibar) et indiens, soit environ
100 000 personnes, sont surtout installés sur la côte. Un tiers environ
des Tanzaniens est animiste, un autre chrétien, et le troisième
musulman. La population est très inégalement répartie et faiblement
urbanisée. Les rives du lac Victoria, les basses pentes du Kilimandjaro
et la partie nord du littoral constituent les zones les plus peuplées.

La Tanzanie figure parmi les pays les plus pauvres du
monde. L'agriculture représente encore près de la moitié du produit
intérieur brut. Le maïs, le manioc, la patate douce et le mil
constituent les principales cultures vivrières, tandis que le café, le
coton, le sisal, le thé, les noix de cajou et les clous de girofle (îles
de Zanzibar et de Pemba) fournissent avec le bois l'essentiel des
exportations. Le cheptel bovin est important. Les ressources minières
(diamants, or, étain, phosphates, charbon, fer) sont très inégalement
exploitées, mais représentent désormais 42 % des recettes à
l'exportation. Le secteur industriel reste très modeste et est dominé
par l'agroalimentaire. Le tourisme sur le littoral et dans les
exceptionnelles réserves de faune (parc national du Serengeti) est en
plein développement depuis les années 1990. Les échanges sont
déficitaires et le pays est très endetté. En dehors de la voie ferrée et
de la route reliant la Zambie à Dar es-Salaam, les voies de
communication restent insuffisantes.
HISTOIRE
Le Tanganyika continental et l'ancien sultanat de l'île de Zanzibar – qui ont formé en 1964 l'État fédéral de Tanzanie – ont entretenu des relations plus qu'étroites depuis l'expansion de l'islam sur la côte orientale de l'Afrique, colonisée par les puissances européennes à la fin du xixe s. C'est au Tanganyika (et au Kenya voisin) que la célèbre famille de paléontologues anglais, les Leakey, a trouvé dans les années 1960 des fragments de squelettes vieux de plusieurs millions d'années dont la découverte a représenté une contribution majeure à la préhistoire de l'humanité. Les Bantous qui peuplent la partie continentale sont probablement arrivés d'Afrique centrale vers le début du premier millénaire et ont introduit l'agriculture et l'usage du fer. Ils n'ont pas formé de royaumes et l'autorité des chefs, les ntemi, ne s'étendait qu'à un groupe de villages. Les Masais nilo-hamites sont arrivés au xviie s., peu avant les Ngonis, venus d'Afrique du Sud au début du xviiie s. avec Zwengendaba, un des généraux de l'Empire zoulou de Chaka.L'implantation arabe et la civilisation swahilie
Entre-temps, à partir du viie s., les navigateurs arabes commercent sur la côte, où ils s'installent progressivement, depuis Mogadishu (aujourd'hui Muqdisho) en Somalie jusqu'à Sofala, au Mozambique. Les cités qu'ils fondent s'enrichissent du trafic de l'or, de l'ivoire et des esclaves avec l'intérieur du pays. Ils y construisent palais et mosquées en même temps que se développe une langue, le swahili, mélange d'arabe et de bantou, dont la transcription en caractères arabes permet l'épanouissement d'une littérature poétique, religieuse et guerrière. Sur la côte tanzanienne, la plus importante de ces cités est Kilwa.
À la fin du xve s., les Portugais s'emparent de ces ports et de Zanzibar, pour en être chassés par les Arabes au milieu du xviie s. Le sultanat d'Oman
établit sa souveraineté sur la côte et sur l'île, qui devient un
important marché d'esclaves. En 1861, le sultanat de Zanzibar rompt ses
liens avec Oman. Les explorateurs anglais Burton, Speke, Livingstone et Stanley sillonnent la région, tandis qu'un chef arabe, Tippoo-Tip,
qui pratique la traite à grande échelle et approvisionne Zanzibar,
étend sa domination à l'intérieur du pays, jusqu'au Congo du roi belge
Léopold II.
La colonisation allemande
Dès le congrès de Berlin (1885), où les puissances européennes se partagent l'Afrique, la compagnie commerciale Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft, créée par Carl Peters, installe le protectorat allemand au Tanganyika et à Zanzibar, dont le sultan loue à bail la bande côtière du Tanganyika à l'Allemagne et celle du Kenya à l'Angleterre. En 1890, l'Allemagne cède Zanzibar à l'Angleterre en échange de l'île d'Helgoland (alors possession britannique) en mer du Nord.
La domination allemande sur l'intérieur du pays, qui
s'étend au Rwanda et au Burundi, se heurte à plusieurs révoltes durement
réprimées, dont en 1905 celle dite « des Maji-Maji ». L'administration
allemande accorde d'importantes concessions à des colons allemands et
construit une ligne de chemin de fer qui va de Dar es-Salaam (en face de
Zanzibar) à Kigoma, sur la rive orientale du lac Tanganyika. Durant les quatre ans que dure la Première Guerre mondiale,
les Allemands, sous la direction du général von Lettow-Vorbeck,
réussissent à échapper aux troupes britanniques et ne se rendent qu'en
1918. L'Afrique orientale allemande est alors placée sous le mandat de
la Société des Nations, qui confie le Tanganyika à la Grande-Bretagne et les royaumes du Rwanda et du Burundi, voisins du Congo belge, à la Belgique.
Le mandat britannique
L'administration anglaise concède les grands domaines des colons allemands à de nouveaux immigrés, Anglais, Sud-Africains, Indiens et Grecs. Un Conseil législatif est installé en 1926, mais les Africains n'y entreront qu'en 1945, après la Seconde Guerre mondiale. Le système de la représentation paritaire des trois communautés (européenne, indienne et africaine) institué par la suite est rapidement abandonné pour faire place à une assemblée où les Africains sont largement majoritaires. En 1954, Julius Nyerere, un instituteur catholique, crée la Tanganyika African National Union (TANU) en même temps que se développe le syndicalisme africain. La TANU remporte les élections de 1960 au Conseil législatif. J. Nyerere devient Premier ministre et le pays accède à l'indépendance en 1961. La république est proclamée en décembre 1962, Nyerere est élu président, le Tanganyika restant membre du Commonwealth. Le swahili – transcrit en caractères latins depuis la colonisation – devient langue officielle.
Zanzibar acquiert à son tour l'indépendance en 1963,
mais dès sa proclamation éclate une violente révolte d'inspiration
communiste contre la domination arabe. Cette révolte est menée par
l'Afro Shirazi Party, qui rassemble les Africains descendants d'esclaves
et la communauté métisse issue en partie d'une immigration persane (des
réfugiés chiites de Chiraz se sont établis à Zanzibar peu avant l'an
1000). Plusieurs milliers d'Arabes sont massacrés et le sultan s'enfuit.
La naissance de la Tanzanie et l'expérience socialiste de Julius Nyerere
En 1964, le Tanganyika et Zanzibar proclament leur union, tout en préservant leur autonomie respective. Le leader de l'Afro Shirazi Party, Abeid Karume, instaure un régime dictatorial qui s'appuie sur l'Allemagne de l'Est et sur la Chine. Il est assassiné en 1972 et remplacé à la tête de l'île par son second, Aboud Jumbé.
En 1967, J. Nyerere inaugure par une déclaration
solennelle à Arusha une expérience socialiste qui consiste à rassembler
les paysans au sein de communautés villageoises dites ujamaa
(« communauté solidaire » en swahili). Dix ans plus tard, il est
contraint de reconnaître lui-même l'échec de cette expérience en raison
de l'opposition des paysans à la « villagisation ». En cette même année
1977, une nouvelle Constitution est adoptée tandis que l'Afro Shirazi
Party et la TANU décident de former un seul parti, le Chama Cha
Mapinduzi (CCM), ou parti de la Révolution, devenu parti unique, mais
Zanzibar conserve son autonomie, avec un exécutif et un législatif
distincts coiffés par des institutions fédérales.
La politique étrangère et la guerre avec l'Ouganda
Sous l'impulsion de J. Nyerere, la Tanzanie, où s'est installé le comité de libération de l'Organisation de l'unité africaine (OUA), s'avère un des pays les plus déterminés parmi les États de la « ligne de front » (Zambie, Angola, Mozambique, Botswana, et plus tard Zimbabwe) opposés au régime d'apartheid sud-africain, à la Rhodésie blanche et au colonialisme portugais. Le gouvernement tanzanien soutient le Frelimo, mouvement de libération du Mozambique, ainsi que les régimes progressistes d'Ali Soilih aux Comores et du président René aux Seychelles. Les liens avec le Kenya et l'Ouganda se distendent et la Communauté économique est-africaine mise en place par les Britanniques est dissoute. En 1981, après un différend frontalier, l'armée tanzanienne intervient en Ouganda contre le président Amin Dada, qui est contraint de s'enfuir malgré l'appui militaire de la Libye. L'ancien président ougandais Milton Obote, qui s'était réfugié à Dar es-Salaam, revient peu après au pouvoir à Kampala.
Le coût de l'expédition militaire tanzanienne en
Ouganda pèse lourdement sur les finances de l'État, déjà éprouvées par
l'échec de l'expérience des villages ujamaa, et J. Nyerere décide
de ne pas se représenter à l'élection présidentielle de 1985 organisée
après une révision constitutionnelle (1984) témoignant d’une première
démocratisation du régime.
C'est le président de Zanzibar, Ali Hassan Mwinyi, du
CCM, qui est élu à la magistrature suprême. Nyerere conserve la haute
main sur le parti unique et critique les orientations libérales de son
successeur, qui est néanmoins réélu en 1990. Cependant, les relations
restent tendues avec Zanzibar, où la tentation d'un séparatisme
d'inspiration musulmane s'accentue. En 1993, les autorités fédérales
obligent Zanzibar, qui a adhéré secrètement à l'Organisation de la conférence islamique (OCI), à s'en retirer.
En 1992, le multipartisme est instauré et intégré
dans la Constitution révisée mais la tension s'accroît entre chrétiens
et musulmans dans la partie continentale du pays.
Les succès démocratiques et diplomatiques des présidents Mkapa et Kikwete
Aux élections de 1995, le CCM et son candidat Benjamin Mkapa, soutenu par J. Nyerere, l'emportent facilement sur A. Mrema, chef de file de la Convention nationale pour la reconstruction et la réforme (CNRR). À Zanzibar, la victoire revient au candidat du CCM, Salmin Amour, qui devance de très peu le Front civique uni (CUF) de Seif Sharif Hamad, favorable à la sécession. S. Amour devient président de l'île et doit faire face à une crise politique qui perdure, l'opposition contestant le résultat des élections. En octobre 2000, Benjamin Mkapa, réélu avec 71 % des suffrages, et son parti (CCM) sortent largement victorieux des élections générales. En revanche, la plus grande confusion règne à Zanzibar, après l'annonce des résultats de la présidentielle, le CUF contestant, comme en 1995, la victoire du candidat du CCM, Aman Abeid Karume. Les dysfonctionnements du scrutin et la méfiance absolue existant entre les deux partis ne permettent pas de véritable apaisement malgré un accord signé en octobre 2001 à la suite de heurts violents. Le scrutin suivant, le 30 octobre 2005, voit la réélection de A. A. Karume, avec 53,2 % des voix, mais il est une fois encore vivement contesté par le candidat du Front civique uni (CUF), S. S. Hamad, crédité de 46,1 % des voix, et marqué par de nouveaux affrontements meurtriers.
Jusqu'à sa mort, survenue en octobre 1999,
l'ex-président Nyerere a continué à inspirer la politique étrangère de
la Tanzanie, notamment dans la région des Grands Lacs, où il était un
des partisans les plus actifs des sanctions contre le régime du
président Buyoya du Burundi,
parvenu au pouvoir par un coup d'État en 1996. En outre, c'est à
Arusha, au nord-est de la Tanzanie, que le Tribunal pénal international
pour le Rwanda (TPIR) s'est installé en mars 1996, afin de juger les
responsables du génocide commis au Rwanda en 1994. En 2003 a pris fin le
rapatriement des derniers réfugiés rwandais, mais 500 000 réfugiés
burundais et congolais se trouvaient toujours dans l'ouest du pays (ils
ne sont plus que 140 000 en septembre 2008). Benjamin Mkapa poursuit
l'œuvre diplomatique de son prédécesseur : avec l'Afrique du Sud, il
parvient à ce qu'un accord pour résoudre la crise burundaise soit signé à
Dar es-Salaam, le 16 novembre 2003. En novembre 2004, la capitale
tanzanienne accueille le sommet inaugural de la Conférence
internationale sur les Grands Lacs tandis qu'un mois auparavant, la
Tanzanie, le Kenya et l'Ouganda, réunis au sein de la Communauté
est-africaine (EAC), ont signé un accord d'union douanière entrant en
vigueur le 1er janvier 2005, avec l'objectif de créer un
marché commun à l'horizon 2010. En 2006, la Tanzanie encourage
l'élargissement de l'EAC au Rwanda et au Burundi, effectif en 2007.
En 2005, le président Mkapa quitte le pouvoir, la
Constitution limitant à deux le nombre de mandats présidentiels. Le
14 décembre, le candidat du CCM, ministre des Affaires étrangères depuis
1995, Jakaya Kikwete, remporte l'élection présidentielle avec 80 % des
voix devant Ibrahim Lipumba (CUF), qui rassemble 11,6 % des suffrages,
et huit autres candidats. Le parti présidentiel obtient 206 sièges sur
232. Le gouvernement lutte en priorité contre la corruption et agit avec
succès en faveur de la scolarisation des enfants. Le président Kikwete,
qui continue à asseoir la Tanzanie dans son rôle de puissance
régionale, est élu à la présidence de l'Union africaine
pour l'année 2008. La coopération avec la Chine – dont les origines
remontent à l’époque de Nyerere – est par ailleurs relancée à l’occasion
de deux tournées africaines du premier ministre Wen Jiabao en 2006 et
du président Hu Jintao en 2009.
En octobre 2010, c’est dans un climat apaisé mais
dans une certaine indifférence (avec une participation d’environ 43 %
contre 72 % en 2005) et à l’issue d’un scrutin non exempt
d’irrégularités malgré le satisfecit des observateurs internationaux,
que J. Kikwete est réélu pour un second mandat avec plus de 61 % des
suffrages devant Willibrod Slaa, secrétaire général du parti pour la
Démocratie et le Développement (Chadema), crédité d’environ 26 % des
suffrages. Si le CCM reste largement hégémonique à l’Assemblée
nationale, dans l’opposition, le Chadema se distingue en progressant de 5
à 22 sièges, tandis que le CUF en obtient 21. À Zanzibar, ces élections
sanctionnent le processus de réconciliation et de pacification entamé
en octobre 2001 mais resté jusqu’ici sans grand effet : à la suite d’un
accord sur le partage du pouvoir entre les deux partis rivaux et un
référendum en juillet ouvrant la voie à la formation d’un gouvernement
d’union nationale, Ali Mohamed Shein, candidat du CCM, remporte de
justesse l’élection présidentielle (50,1 % des voix) face à son rival du
CUF, S.S. Hamad, qui reconnaît cette fois sa défaite et accède au poste
de vice-président.

0 commentaires:
Enregistrer un commentaire