
Le Cambodge
Capitale: Phnom Penh

Nom officiel: Royaume du Cambodge
Population: 15 458 332 habitants (est. 2014) (rang dans le monde: 67)
Superficie: 181 040 km. car.
Système politique: démocratie multipartite dans le cadre d'une monarchie constitutionnelle
Capitale: Phnom Penh
Monnaie: rial
PIB (per capita): 2 600$ US (est. 2013)
Langues: khmer (langue officielle) 96,3%, autres 3,7% (est. 2008)
Religions: bouddhistes 96,9%%, musulmans 1,9%, chrétiens 0,4%, autres 0,8% (est. 2008)
GÉOGRAPHIE
Le pays, au climat chaud et humide, est formé de plaines ou de plateaux recouverts de forêts ou de savanes, entourant une dépression centrale, où se loge le Tonlé Sap et qui est drainée par le Mékong. C'est dans cette zone que se concentre la population (formée essentiellement de Khmers et en grande majorité bouddhiste), qui vit surtout de la culture du riz.1. Le milieu naturel

Le pays a un climat tropical, chaud et humide. Les
pluies d'été sont apportées par la mousson du Sud-Ouest. Les hauteurs
les plus marquées du pays étant perpendiculaires au flux de mousson,
leurs pentes méridionales, « au vent », reçoivent des pluies
considérables (parfois plus de 5 m). La cuvette centrale est, au
contraire, « sous le vent » et ne reçoit, en moyenne, que 1 300 à
1 400 mm de pluie : mais cet effet d'abri ne se fait sentir que de mai à
août, les pluies étant au contraire très abondantes en septembre et en
octobre. Relativement sèche, la cuvette cambodgienne est inondée, en son
centre, par les hautes eaux du Mékong, qui montent à partir de juin et
atteignent leur maximum au début octobre.
2. La population

3. L'économie
La situation économique est marquée par les années de guerre. Le Cambodge est un pays pauvre, avec un revenu annuel par habitant qui est l'un des plus bas du monde. L'agriculture occupe 70 % de la population et constitue le secteur dominant. Dans les plaines centrales, sur les hautes terres de la région de Takéo, une riziculture pluviale est pratiquée de manière extensive, sur de petites propriétés, où elle est souvent associée au palmier à sucre. Les grandes exploitations rizicoles irriguées sont concentrées dans la région de Battambang, la deuxième ville du pays. Jusqu'en 1970, la production de riz, même de faible rendement, dégageait un surplus commercial réduit à néant par les années de guerre (1970-1975), les travaux forcés imposés par les Khmers rouges et le type de collectivisation établi par l'occupation vietnamienne (1979-1989). Malgré le rétablissement de la petite exploitation familiale, l'autosuffisance reste précaire et les superficies cultivées sont moins importantes qu'en 1970 – la guerre a laissé de nombreuses mines antipersonnel et la déforestation excessive a créé des problèmes d'approvisionnement en eau.
Sur les rives du Mékong, du Tonlé Sap et du Bassac s'est développée, depuis le xixe s.,
une polyculture commerciale originale, qui utilise habilement les crues
et leurs limons fertiles pour produire maïs, haricots, tabac, sésame,
arachides, kapok, soja, etc., certaines de ces cultures permettant deux
récoltes par an. L'élevage d'animaux de trait, essentiel pour
l'agriculture, a repris. La pêche est très importante pour le pays, le
poisson étant la première source de protéines pour les Cambodgiens ; la
pêche familiale en eau douce couvre la majeure partie des besoins, les
eaux des lacs, les forêts inondées par les crues du Mékong et les
rivières étant exceptionnellement poissonneuses. Cependant, ces
conditions naturelles favorables sont menacées par la dégradation de
l'environnement. La pêche commerciale existe, mais, en eau douce comme
en mer, elle est le domaine des Chams, des Vietnamiens et des Chinois,
qui subissent de plus en plus la concurrence illégale des pêcheurs
thaïlandais.
Le Cambodge développe également quelques cultures à
vocation commerciale : le caoutchouc dans la région de Kompong Cham, le
poivre dans la zone côtière orientale, des cocoteraies et des cultures
fruitières autour des villes. La forêt est surexploitée : elle couvrait
73 % du territoire en 1969 et seulement 35 à 40 % en 1991. Les autorités
locales, les Khmers rouges, l'armée – responsable de la gestion de
l'exploitation forestière depuis 1994 – ont participé à l'abattage
illégal du bois et à sa contrebande vers la Thaïlande et le Viêt Nam, ce
qui prive le gouvernement de revenus importants et menace les
équilibres écologiques.
Le secteur industriel est dominé par l'habillement,
qui représente la majorité des exportations. Le reste de l'industrie
(rizeries, latex, agroalimentaire, ciment) est modeste et desservi par
un équipement vétuste. Un port, Kompong Som, a été créé sur le golfe de
Siam en 1955. Les ressources minières sont limitées (phosphates utilisés
pour fabriquer des engrais, pierres précieuses de Païlin). Le Cambodge
reste très dépendant de l'aide internationale et il ne parvient pas à
séduire les investisseurs, qui, malgré la libéralisation de l'économie,
reculent devant la corruption et le manque de structures juridiques. La
reprise du tourisme est réelle, avec près de 3 millions d'entrées en
2011.
HISTOIRE
1. Époque du Funan
Du ier au ve s. de notre ère, ce royaume hindouisé se développe dans le delta et le moyen Mékong, avec pour capitale Vyadhapura (près de Bà Phnom, dans la province actuelle de Prey Veng). Le Funan est pendant cinq siècles la puissance dominante d'Asie du Sud-Est et maintient des contacts avec la Chine et l'Inde. Cette dernière exerce une influence déterminante, tant religieuse que culturelle. Au milieu du vie s., le Funan se décompose sous la pression d'un nouveau royaume situé dans le moyen Mékong, le Tchen-la.2. Époque du Tchen-la
Ce royaume s'empare du Funan et étend sa puissance à l'actuel Cambodge. Le roi Ishanavarman (616-635) fonde une capitale, Ishanapura, dans la région de Kompong Thom. Au milieu du viiie s., le Tchen-la se scinde en deux, le Tchen-la de l'eau, maritime et plus proche du monde malais, et le Tchen-la de terre, situé aux confins du nord du Cambodge, de la Thaïlande, du Laos et des hauts plateaux du centre de l'Annam. Les deux Tchen-la seront réunifiés par le premier souverain angkorien, Jayavarman II.3. Époque angkorienne

Son neveu Indravarman Ier, puis le fils de ce dernier, Yashovarman Ier (889-900), vont poursuivre son œuvre et développer Angkor, la capitale. Grand bâtisseur, Rajendravarman (944-968) construit Bantéay Srei et lance des opérations militaires contre le Champa.
Le règne de l'usurpateur Suryavarman Ier (1002-1050), premier grand souverain bouddhiste mahayana, et celui de Suryavarman II (1113-après 1144), bâtisseur d'Angkor Vat,
voient l'apogée de la puissance de l'empire angkorien, qui s'étend sur
le Siam, atteint la Birmanie, la péninsule malaise, et qui lance ses
troupes sur le Champa, le Dai Viêt et contre les Môns. Puissance
éphémère cependant, puisqu'elle n'est pas fondée sur l'occupation
militaire et l'administration directe, le roi khmer se contentant de
faire reconnaître sa suzeraineté et d'installer des gouverneurs locaux.
Ainsi, dès 1177 les Chams
relèvent la tête et mettent à sac Angkor. Il faudra quatre ans au futur
Jayavarman VII pour les chasser et restaurer la monarchie qui va avec
lui briller de ses derniers feux. Le « roi lépreux », qui règne de 1181 à
1218, s'est converti au bouddhisme ; on lui doit le Bayon. Il va restaurer les gloires passées et se venger du Champa, annexé à l'empire de 1203 à 1226.
À partir du xive siècle, la
menace siamoise se précise contre l'empire angkorien avec la fondation,
en 1350, du royaume Ayuthia ; celui-ci s'étend aux dépens de l'empire
khmer, affaibli, et dont la décadence s'amorce. Les hostilités
incessantes tournent à l'avantage des Siamois, qui s'emparent d'Angkor
en 1431, la pillent et emmènent ses habitants en captivité. Trop exposée
à l'envahisseur, la prestigieuse capitale est abandonnée l'année
suivante. En 1434, la cour s'installe aux « Quatre Bras », près du site
de l'actuelle Phnom Penh.
4. La période moderne
L'histoire du Cambodge du xve au xixe siècle est celle des longues luttes qu'il doit soutenir contre ses deux puissants voisins, le Siam et l'Annam, auxquelles s'ajoute l'instabilité interne chronique.
Le prince Ponhéa Yat, couronné en 1441, donne au pays
une brève période de stabilité et de paix, avant d'abdiquer en 1467.
Les rivalités intestines reprennent, avec parfois une intervention
siamoise en faveur d'un prétendant au trône. Ang Chan (1516-1566) tente
de contenir par les armes la pression des Siamois, qu'il bat près
d'Angkor dans un lieu qui devient Siem Réap (« La défaite des
Siamois »). Il transfère sa capitale à Lovêk. Ses successeurs se
disputent à leur tour le pouvoir et ne parviennent pas à repousser une
invasion siamoise, qui s'achève par la prise de Lovêk (1594).
C'est vers le milieu du xvie siècle
que les premiers Européens arrivent au Cambodge, missionnaires,
commerçants et aventuriers, Espagnols ou Portugais ; une tentative de
deux d'entre eux, Veloso et Ruiz, pour prendre le contrôle du royaume
échouera en 1559.
Après la chute de Lovêk, le Cambodge est devenu le
vassal du Siam. Le roi Chey Chêtthâ II tente de secouer le joug siamois,
repousse les armées venues de l'ouest et, pour se renforcer, va
chercher un appui du côté de l'empire d'Annam, dont il a épousé une des
princesses. C'est le début de la politique khmère d'équilibre précaire
entre ses deux voisins, et le commencement de l'influence de la cour de Huê
dans ce qui deviendra le sud du Viêt Nam et qui est encore cambodgien.
L'Annam, qui vient d'écraser le Champa et qui amorce sa « marche vers le
sud », obtient du roi l'autorisation de fonder des comptoirs dont l'un
deviendra Saigon.
La colonisation vietnamienne du delta du Mékong va s'intensifier. Le
Cambodge sera d'autant moins à même de s'y opposer qu'il est déchiré
pendant tout le xviiie siècle par des guerres
civiles ; parallèlement, la pression siamoise ne se relâche pas et
Ayuthia annexe des pans de l'ancien empire angkorien.
En 1794, le roi Ang Eng est couronné par le roi de
Siam et ramené à Oudong, la capitale, par une armée siamoise ; les
provinces de Battambang et de Siem Réap sont annexées de facto au Siam.
Ang Eng ne règne que deux ans. Le Cambodge devient le terrain de
bataille entre Siamois et Annamites, ces derniers s'étant définitivement
installés dans le delta du Mékong. Ang Chan II (1806-1834), fils d'Ang
Eng, se constitue vassal de l'empereur d'Annam.
Le Siam considère cette décision inacceptable et la
lutte reprend entre Siamois et Annamites, ces derniers prenant le dessus
et occupant le Cambodge. Cette domination, souvent brutale, se
concrétise en 1835 par l'installation sur le trône d'une femme, la
princesse Ang Mei, sans pouvoir réel. Une vietnamisation accélérée du
pays s'ensuit ; le Cambodge sera même annexé en 1841 par l'empire
d'Annam. Les Khmers
réagissent à cette situation en prenant les armes, avec le soutien
militaire du Siam. Le général Bodin conduit une armée qui a pour mission
de placer sur le trône Ang Duong, frère cadet d'Ang Chan II. Huê et
Bangkok, incapables de l'emporter, s'accordent pour exercer une
cosuzeraineté sur un royaume qui s'est réduit comme une peau de chagrin,
et qui compte à peine un million d'âmes sur un territoire ruiné.
Couronné en 1847, Ang Duong
tente, en 1854, d'obtenir l'appui de la France ; mais la mission
envoyée l'année suivante et dirigée par Charles de Montigny échoue. Le
roi veut préserver l'existence de son royaume, dont il craint la
disparition à la suite d'un partage entre le Siam et l'Annam ; en même
temps, il tente de réformer l'Administration et de restaurer l'économie.
5. Le protectorat français
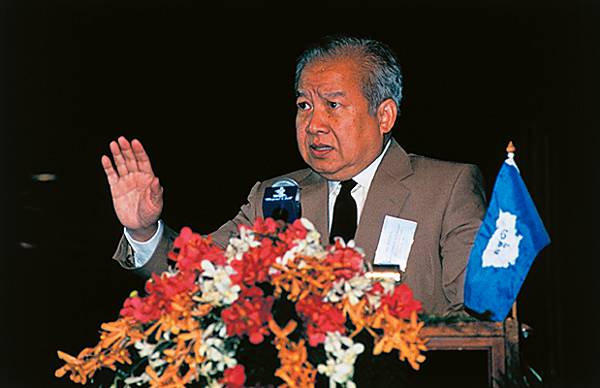
De 1865 à 1867, il doit faire face à l'insurrection
populaire dirigée par Po Kombo ; il est contraint de faire appel aux
forces coloniales venues de Cochinchine. Par le traité de 1867, et en
échange de la reconnaissance de la suzeraineté siamoise sur les
provinces de Battambang et de Siem Réap – qui seront restituées par le
traité de 1907 –, la France obtient de Bangkok le renoncement à ses
droits sur le Cambodge. Paris tente de renforcer son emprise sur le
royaume en forçant Norodom, qui a entrepris d'importantes réformes, à
signer la convention du 17 juin 1884, par laquelle il abandonne en fait
tous ses pouvoirs à un résident qui exerce une autorité directe sur
l'Administration. Une insurrection éclate aussitôt, avec la connivence
du roi.
En 1886, ne pouvant mater le soulèvement, la France
propose une application plus souple de la convention et le
rétablissement de l'autorité royale ; convoqués par le roi, les rebelles
se soumettent. Toutefois, l'emprise coloniale ne va pas cesser de
s'affirmer, tandis que des rectifications de frontières sont effectuées
au profit de la Cochinchine et de l'Annam.
Le pouvoir colonial s'efforce de moderniser l'Administration et l'économie khmères. Dans ce domaine, le roi Sisovath,
qui succède à son frère (1904), va poursuivre l'œuvre entreprise par
Norodom. Le développement économique s'accompagne de l'arrivée de
nombreux Chinois et surtout de Vietnamiens ; ces derniers forment une
importante communauté (commerçants, fonctionnaires, ouvriers des
plantations, pêcheurs). À la mort de Sisovath (1927), son fils aîné,
Monivong, lui succède. Le royaume subit durement le contrecoup de la
grande crise de 1929.
En janvier 1941, profitant de la défaite française et
de la présence des Japonais, le Siam attaque le Cambodge pour reprendre
les provinces de Battambang et de Siem Réap. Tenus en échec sur le
terrain, les Siamois obtiennent néanmoins satisfaction par le biais
d'une « médiation » japonaise (11 mars). Le 23 avril, Monivong meurt.
Sous la pression de l'amiral Decoux,
représentant français en Indochine, inquiet de la réputation de
démocrate de Monireth, fils aîné du roi défunt, le Conseil de la
couronne choisit un jeune prince de dix-huit ans, Norodom Sihanouk,
arrière-petit-fils de Norodom par son père et de Sisovath par sa mère ;
il est couronné le 28 octobre. Les Japonais apportent leur soutien à un
jeune dirigeant nationaliste originaire de Cochinchine, Son Ngoc
Thanh ; celui-ci doit toutefois s'enfuir à Tokyo pour échapper à la
police française.
À la suite du coup de force du 9 mars 1945, les
Japonais prennent le contrôle direct de l'Indochine et invitent Sihanouk
à proclamer l'indépendance, ce qu'il fait dès le 12. Son Ngoc Thanh est
nommé ministre des Affaires étrangères (1er juin), puis
Premier ministre (14 août). Les Français l'arrêtent dès leur retour
(16 octobre). Sihanouk, qui n'a pas les moyens de résister aux Français,
signe le modus vivendi du 7 janvier 1946, qui prévoit seulement
l'autonomie interne du royaume dans le cadre de l'Indochine.
Une résistance au retour des Français prend corps.
Elle donnera naissance à deux mouvements : l'un – les Khmers Issarak,
qui deviendront plus tard les Khmers Serei – dirigé par Son Ngoc Than,
de droite et antisihanoukiste, qui poursuivra la lutte contre Sihanouk
jusqu'à sa chute en 1970, avec le soutien de Bangkok, de Saigon et des
États-Unis ; l'autre, dirigé par Son Ngoc Minh, de gauche, qui sera
largement contrôlé par le Viêt-minh et formera un gouvernement provisoire en 1951.
Une opposition légale, le parti démocrate du prince Youthevong, remporte les trois quarts des sièges aux élections du 1er septembre 1946. En octobre, Bangkok restitue les deux provinces annexées en 1941.
Le 6 mai 1947, le Cambodge devient une monarchie
constitutionnelle, tandis que le conflit entre Sihanouk et les
démocrates se poursuit (il durera jusqu'en 1952) et que la guerre fait
rage en Indochine. À force de pressions et d'habile diplomatie, Sihanouk
obtient une indépendance assortie de limites (8 novembre 1949) ; en
1952, il se proclame Premier ministre. L'année suivante il lance sa
« croisade pour l'indépendance », par laquelle il entend également
couper l'herbe sous le pied aux mouvements de résistance. L'effet est
immédiat : il obtient l'indépendance totale (3 juillet), qui sera
confirmée lors de la conférence de Genève de 1954.
6. L'accession à l'indépendance
Dès la conférence de Genève, Sihanouk s'oppose avec succès à la tentative du Viêt Nam de Hô Chi Minh de faire connaître des zones « libérées » à ses partisans « Khmers Viêt-minh ». Phnom Penh ne veut pas pour autant tomber dans l'orbite des États-Unis (qui accordent une aide économique et militaire) et refuse d'entrer dans l'Organisation du traité de l'Asie du Sud-Est (OTASE), fondée en septembre 1954.
L'année suivante, le Cambodge quitte l'Union française. Sihanouk se rapproche du neutralisme, qui s'exprime lors de la conférence de Bandung
(avril 1955). Il établit des relations diplomatiques avec l'URSS
(1956), puis avec la Chine (1958). Entre-temps, l'Assemblée nationale a
voté (1957) la « neutralité » du royaume. L'hostilité et les
revendications territoriales de la Thaïlande et du Viêt Nam du sud,
alliés des États-Unis, accroissent la méfiance de Sihanouk envers
Washington, tandis que ses relations avec Hanoi et Pékin se resserrent.
Le 7 février 1955, Sihanouk fait approuver sa
politique par référendum. Le 19, il fait adopter une réforme
constitutionnelle selon laquelle le gouvernement n'est plus responsable
devant l'Assemblée mais devant le roi. Il abdique le 2 mars en faveur de
son père, Norodom Suramarit, et fonde en avril le Sangkum Reastr Niyum
(communauté socialiste populaire), qui remporte tous les sièges aux
élections du 11 septembre et qui les conservera aux élections de 1958.
En 1958-1959 et en 1963, le parti communiste
Prachacheon est frappé par une répression sévère. Ses membres les plus
radicaux, sous la conduite de Touch Samuth, puis de son successeur
Saloth Sar (qui deviendra Pol Pot) et de Ieng Sary, forment, avec une
partie des survivants du parti populaire révolutionnaire – créé en 1951
après l'éclatement du parti communiste indochinois –, un parti
communiste khmer (30 septembre 1960). Organisation clandestine, ce parti
prend le maquis en 1963 et se lance dans la lutte armée à partir de
janvier 1968. Proche de Pékin, il n'aura pas de rapports avec les
communistes khmers réfugiés à Hanoi après 1954.
Il existe aussi une gauche légale, représentée surtout par trois députés, Khieu Samphan, Hou Youn et Hu Nim ; les deux premiers seront brièvement ministres (1962), avant de prendre eux aussi le maquis (1967).
La détérioration des rapports avec la Thaïlande et le
Viêt Nam du Sud conduit à la rupture avec ces deux pays (1961 et 1963).
En 1962, la Cour internationale de justice de La Haye tranche en faveur
du Cambodge le conflit portant sur le temple de Preah Vihear, qui doit
lui être restitué par Bangkok. Avec Saigon, les incidents frontaliers se
multiplient. Au même moment, les adversaires du prince – conduits par
Son Ngoc Thanh et ses Khmers Serei, réfugiés en Thaïlande et au Viêt Nam
du Sud – complotent pour le renverser, avec l'appui de services
spéciaux américains. Le prince renonce à l'aide militaire américaine
(novembre 1963), et les relations diplomatiques sont mises en sommeil
(14 décembre). Le 1er janvier 1964, l'aide économique
américaine cesse. Les relations diplomatiques sont rompues en mai, après
l'incident de Chantrea, au cours duquel les troupes de Saigon sont
entrées au Cambodge. Le prince relance son initiative en faveur de la
neutralisation de son pays et de la reconnaissance de ses frontières.
Les États-Unis et leurs alliés refusent d'y souscrire ; le FNL
sud-vietnamien et Hanoi les reconnaissent (1967).
La brouille du Cambodge avec les États-Unis le rapproche du camp socialiste, mais aussi de la France ; le général de Gaulle
se rend en visite officielle à Phnom Penh (30 août-2 novembre 1966) et y
prononce un important discours, où il condamne la politique
d'intervention américaine.
Sur le plan intérieur, le prince renforce le contrôle
étatique sur l'économie et le commerce par une série de réformes dont
auront rapidement raison la mauvaise gestion et la corruption. Le fossé
entre villes et campagnes s'élargit ; les Khmers rouges en profitent
pour renforcer leur influence sur les paysans. En 1966, le prince décide
de ne plus choisir les candidats du Sangkum aux élections ; il s'ensuit
un triomphe de la droite et la formation d'un gouvernement Lon Nol.
Pour y remédier, le prince, devenu chef de l'État depuis la mort de son
père en 1960 – sa mère, la reine Kossamak, continuant à symboliser le
trône –, crée un « contre-gouvernement ».
7. La crise
Le 2 avril 1967, les paysans de Samlaut, dans la province de Battambang, se révoltent contre les exactions de l'administration locale ; Lon Nol noie le soulèvement dans le sang. Il est remplacé à la tête du gouvernement par l'économiste Son Sann (1er mai). Peu après, la révolution culturelle chinoise fait son apparition à Phnom Penh. Sihanouk riposte en dissolvant les organisations sino-cambodgiennes (septembre) et en menaçant Pékin de remettre en cause les relations entre les deux pays. Zhou Enlai répond par un message conciliant. Mais un certain nombre de Cambodgiens de gauche jugent plus prudent de se réfugier en France ou de rejoindre les Khmers rouges.
En novembre, Sihanouk prend la tête d'un « cabinet
d'urgence » ; en janvier 1968, il cède la place à son fidèle Penn Nouth
pour un « gouvernement de la dernière chance » ; en novembre, Lon Nol
y devient ministre de la Défense. Une révolte tribale éclate à
Ratanakiri. Les Américains autorisent la poursuite des Vietnamiens sur
le territoire cambodgien, en dépit des protestations du prince. En mars
1969, Nixon et Kissinger ordonnent le bombardement clandestin du
Cambodge. Mais, en avril, les États-Unis reconnaissent les frontières du
royaume, prélude à la reprise des relations diplomatiques (août). En
mai, Sihanouk a reconnu le Gouvernement révolutionnaire provisoire (GRP) sud-vietnamien.
En août 1969, le cabinet Penn Nouth est renversé ;
Lon Nol lui succède, avec à ses côtés un autre adversaire déterminé de
Sihanouk, son cousin Sirik Matak. Des contacts se nouent secrètement
avec Washington, Saigon et Bangkok, qui souhaitent eux aussi se
débarrasser du prince et détruire les « sanctuaires » vietnamiens du
Cambodge. Le 18 mars 1970, Sihanouk est renversé par l'Assemblée, sous
la pression du gouvernement et de l'armée, alors qu'il part pour Pékin.
Cheng Heng devient chef de l'État.
8. La guerre
La neutralité proclamée par les auteurs du coup d'État du 18 mars ne les empêche pas de se placer du côté des États-Unis et de Saigon ; le général Lon Nol lance un ultimatum aux troupes de Hanoi et du G.R.P. pour qu'elles quittent le Cambodge, avant d'expulser leurs diplomates et de rompre avec eux. En même temps, il fait appel aux Américains pour une aide militaire. Dès le 20 mars, des troupes saigonnaises ont franchi la frontière cambodgienne pour attaquer des bases communistes. Le 26, l'armée ouvre le feu pour arrêter une marche de partisans du prince Sihanouk sur Phnom Penh. Au début d'avril, cette armée se livre au massacre de milliers de résidents vietnamiens. Nixon et le général Nguyên Van Thiêu renforcent leurs pressions sur les dirigeants cambodgiens afin qu'ils entrent ouvertement dans la guerre.
À Pékin, Sihanouk reçoit l'appui de la Chine et des
Khmers rouges pour mener la lutte contre Lon Nol. Le 20 avril 1970 est
créé le Front uni national du Kampuchéa (FUNK), présidé par Sihanouk,
suivi, le 5 mai, de la création du Gouvernement royal d'union nationale
du Kampuchéa (GRUNK), dirigé par Penn Nouth. Khieu Samphan, vice-Premier
ministre, dirige la résistance sur le territoire khmer. Les 24-25 avril
se tient à Canton la Conférence des peuples indochinois, avec Sihanouk,
Pham Van Dong (RDV), Nguyên Huu Tho (GRP) et Souphanouvong (Pathet Lao),
qui décide l'unification de la résistance. Sur le terrain, la guerre a
commencé, menée par les révolutionnaires vietnamiens, appuyés par les
Khmers rouges et de nombreux partisans du prince. Le 30 avril, Nixon
annonce l'entrée des troupes américaines au Cambodge, le lendemain de
celle des forces saigonnaises. Devant l'opposition de son opinion
publique, il doit promettre qu'elles se retireront avant le 30 juin.
Cette offensive permet au régime Lon Nol de ne pas s'effondrer ; mais
elle ne parvient pas à réduire les « sanctuaires » communistes, qui se
déplacent plus avant à l'intérieur du Cambodge, contribuant à faire
entrer celui-ci tout entier dans le conflit. Le 4 juin, une partie des
temples d'Angkor est occupée par le GRUNK. Sauvé de la défaite, le
gouvernement – qui proclamera la république le 9 octobre 1970 – est en
fait maintenu à bout de bras par ses alliés. Cette situation durera cinq
ans.
Après le départ des troupes américaines le 30 juin et
malgré les bombardements américains qui continuent, les
révolutionnaires khmers étendent leur emprise sur le pays. En août,
Sihanouk affirme que ses partisans contrôlent les deux tiers du
territoire. Les Khmers rouges vont progressivement prendre le pas sur
les sihanoukistes et remplacer au combat les Vietnamiens. Ces derniers
repartent vers le Viêt Nam lors de l'offensive de 1972 et après les
accords de Paris (février 1973). À ce moment, la tension monte entre
révolutionnaires des deux pays, les Khmers rouges reprochant à leurs
alliés de vouloir leur imposer de négocier avec Phnom Penh, comme eux
avec Saigon et Washington, et le Pathet Lao avec Vientiane. L'offensive
khmère rouge marque le pas. Lorsque les Américains cesseront leurs
bombardements, en août 1973, les maquisards seront tellement affaiblis
qu'ils seront incapables de lancer l'assaut final attendu contre Phnom
Penh.
Frappé d'hémiplégie, Lon Nol, qui est devenu maréchal
(21 avril 1971) et président de la République (4 juin 1972), est
entouré de conseillers corrompus. Les défaites militaires se succèdent,
et les maquisards parviennent à lancer des coups de main jusque dans la
capitale. Malgré cela, Phnom Penh et Washington persistent dans la
guerre, affirmant qu'ils ne combattent que les Vietnamiens. Sur le
terrain, les Khmers rouges éliminent, les uns après les autres,
sihanoukistes et communistes provietnamiens, et renforcent leur contrôle
du G.R.U.N.K. Quand Sihanouk se rend au Cambodge (mars 1973), il
réalise qu'il n'a plus aucun pouvoir réel.
Gouvernant un pays ruiné, où ses soldats ne
s'aventurent plus guère dans les campagnes, Lon Nol ne parvient pas non
plus à assurer la stabilité de son régime.
Sur le plan diplomatique, le GRUNK est admis au sein
du mouvement des non-alignés (août 1972) et reconnu, de facto, par
l'URSS (octobre 1973). Moscou, toutefois, maintiendra des diplomates à
Phnom Penh jusqu'à sa prise par les Khmers rouges. Le 1er janvier
1975, les Khmers rouges lancent leur offensive finale contre Phnom
Penh. Le 17 avril, ils entrent dans la capitale, après le départ de Lon
Nol et des Américains.
9. Le régime khmer rouge
Le premier acte des vainqueurs est de vider les villes de leurs habitants ; ces citadins déracinés vont être, avec le reste de la population – divisée en « peuple ancien » et « peuple nouveau » –, progressivement embrigadés dans des coopératives ; les conditions de vie y sont très difficiles, tandis que le travail y est intense et la répression féroce envers ceux qui sont soupçonnés d'avoir travaillé pour le régime républicain. Faible, divisé, manquant de cadres, armé d'une idéologie au nationalisme et à l'autoritarisme extrêmes, le nouveau pouvoir s'affirme par la répression.
Jusqu'à l'intervention vietnamienne de 1978, la réalité du pouvoir sera détenue par l'Angkar,
organisation restée secrète jusqu'en 1977. L'Angkar prône l'esprit de
lutte, l'idée de responsabilité communautaire et la vertu d'obéissance ;
elle s'appuie essentiellement sur l'armée.
L'Angkar offre un exemple unique dans l'histoire des
révolutions asiatiques ; la dictature du prolétariat, ailleurs soutenue
par un culte de la personnalité, est dirigée au Cambodge par une
organisation qui, quoique omniprésente, reste une entité floue et
abstraite.
Pendant les premiers mois, le prince Sihanouk,
toujours chef de l'État, continue de symboliser le régime sans exercer
d'autorité réelle ; il effectue un court séjour à Phnom Penh (septembre
1975), avant d'entreprendre une grande tournée internationale et de
représenter son pays à l'Assemblée générale des Nations unies. De retour
au Cambodge (janvier 1976), il participe aux élections du 20 mars,
organisées en vertu de la nouvelle Constitution, et est élu député de la
capitale. Le 5 avril, il démissionne de son poste. Le Kampuchéa
démocratique se donne un nouveau chef de l'État, Khieu Samphan, et un
Premier ministre, Pol Pot. Le pays demeure fermé au monde extérieur et n'a de relations étroites qu'avec Pékin.
Dès mai 1975, des incidents éclatent entre le Viêt
Nam et le Kampuchéa. Le 31 décembre 1977, Khieu Samphan annonce la
rupture des relations diplomatiques avec le Viêt Nam.
Sur le plan intérieur, des travaux gigantesques
transforment un pays ravagé par la guerre, les bombardements, et
bouleversé par l'exode. Mais le prix en est extrêmement lourd, puisqu'on
a pu parler de centaines de milliers de victimes mortes de faim, de
maladie ou exécutées sommairement. L'éducation, même primaire, est
pratiquement supprimée, les personnes éduquées étant suspectes. Les
familles sont souvent séparées. En même temps, les divisions au sein du
régime se manifestent par des purges parfois sanglantes et de plus en
plus nombreuses, surtout en 1977. La base du régime se rétrécit. Le
prince Sihanouk et Penn Nouth vivent en résidence surveillée, isolés,
tandis que de nombreux partisans du GRUNK croupissent dans des camps. La
fin de 1978 – après que Pol Pot eut consolidé son pouvoir et entamé une
timide ouverture vers le monde extérieur – verra une relative
normalisation.
10. L'intervention vietnamienne
En décembre 1977, les Vietnamiens ont lancé une nouvelle offensive. Devant la résistance opiniâtre des soldats cambodgiens, ils se sont retirés, emmenant avec eux une partie de la population. En mai 1978, éclate, dans la zone frontalière « 203 », une révolte conduite par un proche de Pol Pot, le vice-président de l'Assemblée, So Phim ; elle est écrasée dans le sang, et So Phim est tué. Les dirigeants vietnamiens, ne pouvant plus compter sur un groupe de rechange au Cambodge même, lancent alors une offensive générale le 25 décembre. Auparavant, le Viêt Nam a signé à Moscou un traité avec l'URSS (3 novembre) et a annoncé la création d'un Front uni de salut national du Kampuchéa (FUNSK) le 3 décembre.
Le 7 janvier 1979, les soldats vietnamiens entrent
dans Phnom Penh et, quelques jours plus tard, ils occupent toutes les
villes et les grands axes du pays. Le Kampuchéa démocratique s'effondre.
Le prince Sihanouk est autorisé à prendre l'avion pour Pékin. Avant de
prendre le maquis, Pol Pot a lancé un appel à la guérilla, et son
ministre des Affaires étrangères, Ieng Sary, a demandé la convocation
d'urgence du Conseil de sécurité des Nations unies.
Le lendemain de la prise de Phnom Penh, un Conseil
révolutionnaire faisant fonction de gouvernement est mis en place,
présidé par Heng Samrin, président du FUNSK. Le principal dirigeant est
le vice-Premier ministre et ministre de la Défense, Pen Sovan, chef du
petit parti communiste provietnamien. L'administration du pays demeure
sous tutelle du corps expéditionnaire vietnamien. Le régime prend le nom
de République populaire du Kampuchéa.
Le Premier ministre vietnamien se rend à Phnom Penh
pour conclure un traité d'amitié (18 février), légalisant la présence
vietnamienne et intégrant de fait le Cambodge dans un ensemble
indochinois sous l'égide de Hanoi ; un accord similaire sera conclu
entre le Cambodge et le Laos (23 mars). Tout en s'affirmant non-aligné,
le nouveau régime se place clairement dans le camp soviétique. En
avril-mai, l'armée vietnamienne lance une nouvelle offensive qui
repousse les Khmers rouges vers la frontière thaïlandaise. De nombreux
réfugiés, fuyant les Vietnamiens, mais aussi la faim et la maladie, s'y
sont regroupés. Certains sont sous le contrôle d'organisations de
résistance ou de groupes armés qui vivent de l'aide internationale et de
la contrebande. Car la situation alimentaire et sanitaire a ému
l'opinion internationale et l'aide afflue à la frontière, puis vers
Phnom Penh.
Battus militairement, les Khmers rouges poursuivent la lutte, soutenus par la Chine, les pays de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE ou Asean)
et par certains pays occidentaux. Cette convergence permet aux Khmers
rouges de conserver leur siège aux Nations unies (novembre 1979) et de
rester reconnus par la plupart des pays, tandis que la République
populaire n'est reconnue que par le bloc soviétique et par quelques pays
du tiers-monde dont l'Inde (juillet 1980). Les deux camps se
structurent : à Phnom Penh, où Heng Samrin cumule la direction de l'État
et du Parti (PPRK, parti populaire révolutionnaire du Kampuchéa), après
l'élimination de Pen Sovan (décembre 1981), une Constitution est
adoptée (juin 1981), et Hun Sen
devient Premier ministre en 1985 ; de l'autre côté, un gouvernement de
coalition en exil, constitué en juin 1982, regroupe, sous la présidence
du prince Sihanouk, les royalistes du Funcipec (Front uni national pour
un Cambodge indépendant, neutre, pacifique et coopératif), les
nationalistes de Son Sann et les embarrassants Khmers rouges, dirigés
par Khieu Samphan
– qui a succédé à Pol Pot en 1979. Étrange alliance d'ennemis, fondée
exclusivement sur l'opposition à l'occupation vietnamienne et dont
l'équilibre est menacé par la supériorité militaire des Khmers rouges,
soutenus par la Chine, via la Thaïlande. Mais, malgré des offensives
successives, il s'avère peu à peu que la solution à la crise ne sera pas
militaire. Sous la pression internationale – rôle de l'URSS auprès de
Hanoi, efforts de la France (rencontre entre le prince Sihanouk et Hun
Sen, en décembre 1987) et de l'Indonésie (réunion des quatre factions
cambodgiennes à Bogor, en juillet 1988), résolution de l'ONU du
3 novembre 1988 –, les parties en présence s'orientent vers des
négociations en vue d'une réconciliation nationale. Non sans mal : la
conférence de Paris d'août 1989 est un échec. Cependant, l'essentiel des
troupes vietnamiennes quitte le Cambodge fin 1989, alors que Phnom Penh
tempère son économie socialiste et que la République populaire du
Kampuchéa redevient l'État du Cambodge (avril 1989). En 1990, à l'ONU,
les États-Unis retirent leur soutien au prince Sihanouk : ils refusent
désormais de voter pour que le siège du Cambodge soit attribué à son
gouvernement, en raison de la participation des Khmers rouges à la
coalition. Sous la pression internationale, cette participation prend
ainsi fin en 1992. Simultanément, à la suite de la tourmente qui
bouleverse le monde communiste, le gouvernement provietnamien de Phnom
Penh perd l'aide fournie depuis 1980 par l'URSS et le Comecon.
11. La difficile pacification du Cambodge
11.1. Vers une stabilisation politique
Des accords de paix sont finalement signés, à Paris, le 23 octobre 1991. Ceux-ci prévoient des élections en 1993 sous administration de l'ONU. Le Cambodge reste pourtant en état de guerre, et l'Apronuc (Autorité provisoire des Nations unies au Cambodge) a fort à faire pour organiser le retour à la vie normale – avec, notamment, les questions du rapatriement de 400 000 réfugiés et du désarmement des forces en présence. Le prince Sihanouk devient, en juillet 1991, président d'un Conseil national suprême (CNS), dont les postes sont également répartis entre les deux gouvernements rivaux – et non entre les quatre factions, comme le réclamaient les Khmers rouges. En novembre 1991, le prince et le CNS s'installent à Phnom Penh. Le PPRK, transformé en parti du Peuple cambodgien (PPC, toujours provietnamien), se prononce pour le multipartisme, et Heng Samrin laisse la direction du parti à Chea Sim.
Malgré la permanence du climat de violence et l'obstruction des Khmers rouges,
des élections sont organisées en mai 1993. Avec une forte
participation, elles donnent la victoire au Funcinpec – dirigé par le
prince Norodom Ranariddh,
fils du prince Sihanouk –, qui l'emporte sur le PPC avec plus de 45 %
des voix. Un gouvernement provisoire de coalition est alors mis en place
sous la double présidence du prince Ranariddh et de Hun Sen.
La nouvelle Constitution, promulguée en septembre, rétablit la
monarchie : Norodom Sihanouk est proclamé roi le 24 septembre, puis,
respectivement, Norodom Ranariddh, « premier Premier ministre », et Hun
Sen, « second Premier ministre ». Malgré le rétablissement de certaines
libertés – celle de la presse, entre autres –, le climat politique
demeure tendu, et, alors qu'il serait urgent de relancer l'économie, le
manque de transparence, la corruption, l'incurie et la violence
politique restent omniprésents. La rivalité entre les deux Premiers
ministres s'aggrave, chacun d'eux affrontant parallèlement des divisions
dans son propre camp.
Arguant de complots royalistes, Hun Sen évince le
prince Ranariddh par un coup de force en juillet 1997, suscitant la
condamnation de la communauté internationale. Aux élections de juillet
1998, dont l'organisation a été contestée par l'opposition, les 41,4 %
des voix du PPC de Hun Sen, contre 31,7 % pour le Funcinpec et 14 % pour
le « parti de Sam Rainsy » (PSR, nouveau nom du parti de la Nation
khmère fondé en 1995 par cet ancien ministre des Finances exclu du
gouvernement puis du Funcinpec), rendent inévitable une nouvelle
coalition gouvernementale.
Sous l'égide du roi Norodom Sihanouk, Norodom
Ranariddh et Hun Sen parviennent, après plusieurs mois de tractations, à
un accord politique (novembre 1998). Les deux principaux partis du pays
(PPC et Funcinpec) constituent un gouvernement de coalition, présidé
par Hun Sen. Le prince Ranariddh devient président de l'Assemblée
nationale.
Le Cambodge commence à réintégrer les organisations
régionales et internationales, comme en témoigne son admission au sein
de l'Asean en mars 1999. Malgré quelques avancées, il rencontre toujours
des difficultés avec ses voisins, la Thaïlande et le Viêt Nam, alors
que ses relations avec la Chine, au beau fixe, se resserrent encore par
la multiplication de visites de responsables chinois à Phnom Penh
(2000-2001).
11.2. Vers un apurement du passé

Les redditions – ou arrestations, selon le cas – de
hauts responsables khmers rouges fin 1998 et début 1999 relancent le
débat sur le type de tribunal – national ou international – devant
lequel doivent être traduits les responsables des crimes de guerre et
des crimes contre l'humanité commis au Cambodge dans la seconde moitié
des années 1970. La solution d'un tribunal national ouvert à une
coopération de juges et de procureurs étrangers est finalement retenue.
En 2001, l'Assemblée nationale et le Sénat adoptent la législation
relative à la création du tribunal, qui est entérinée par le Conseil
constitutionnel puis ratifiée par le roi Sihanouk (août).
Après de nombreux échecs, dont le retrait de l'ONU du
processus des négociations en mars 2002, faute de garanties sur
l'indépendance et l'objectivité du tribunal, un accord est finalement
trouvé en juin 2003, prévoyant la création de tribunaux d'exception
devant travailler dans le cadre du système judiciaire du royaume, les
Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (CETC). Mais
leur mise en place effective se heurte à de nombreux obstacles d'ordre
politique, bureaucratique, juridique et financier.
À partir de juillet 2007, cinq hauts dirigeants de
l'ancien régime sont inculpés de crimes contre l'humanité ainsi que,
pour trois d'entre eux, de crimes de guerre, et mis en détention : Nuon
Chea (ex-numéro 2 du régime), Ieng Sary (ex-ministre des Affaires
étrangères), son épouse Ieng Thirith (ex-ministre des Affaires
sociales), Khieu Samphan (ex-chef de l'État du Kampuchea démocratique)
et Kaing Guek Eav, alias Duch (qui dirigea le plus important centre
pénitentiaire khmer rouge, le S-21, arrêté en 1999). Le 17 février 2009,
avec la comparution de ce dernier en audience préliminaire devant la
Chambre de première instance des CETC, s'ouvre ainsi le premier procès
d'un dignitaire du régime khmer rouge. Alors que la santé déclinante des
accusés (I. Sary meurt en mars 2013) et le manque de moyens financiers
font craindre un enlisement général des procédures en cours, il faut
attendre février 2012 pour que Duch soit condamné à la prison à
perpétuité.
11.3. L'hégémonie du PPC et la division des royalistes
Les élections législatives de juillet 2003 voient la victoire du PPC de Hun Sen (73 députés sur 123), devant le Funcinpec du prince Norodom Ranariddh (26 sièges) et le parti de Sam Rainsy (PSR, 24 sièges). Toutefois, la formation d'un gouvernement se heurte à la majorité des deux tiers imposée en 1993. En novembre, le Funcinpec et le PSR acceptent, sous la pression du roi Norodom Sihanouk, de faire partie d'un gouvernement dirigé par Hun Sen, vice-président du PPC et Premier ministre sortant, mais la crise se durcit en janvier 2004, avec l'assassinat du principal dirigeant syndical du royaume, Chea Vichea. Après l'adoption par les deux chambres d'une procédure controversée de « vote bloqué », l'Assemblée nationale parvient à se réunir et à investir, en juillet, le gouvernement, présidé par Hun Sen. Norodom Ranariddh conserve la présidence de l'Assemblée nationale.
Parallèlement, souhaitant régler sa succession de son
vivant afin de préserver l'institution royale, le roi Norodom Sihanouk
annonce, en octobre 2004, vouloir prendre sa retraite et voir son
dernier fils, Norodom Sihamoni, prendre sa succession sur le trône. Ce dernier est élu par le Conseil du trône le 14, et intronisé le 29.
La même année, le Cambodge, qui a signé avec l'Union européenne un accord concernant l'accès aux marchés en juin 2003, devient, le 13 octobre, le 148e État membre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).
Dans la perspective des élections législatives de
juillet 2008, Hun Sen peut mettre en avant les effets bénéfiques de
cette politique de libéralisation (un taux de croissance du PIB de plus
de 12 % en moyenne entre 2004 et 2008 selon la Banque mondiale) face à
une opposition qui dénonce de son côté la corruption et l'insuffisance
des mesures contre la pauvreté ; ces thèmes de campagne sont cependant
éclipsés par un différend frontalier avec la Thaïlande autour du temple
de Preah Vihear, qui ravive le sentiment nationaliste.
Le PPC l'emporte largement avec 90 sièges devant le
PSR (26 députés) qui accuse le pouvoir de fraude. Les sièges restants se
répartissent entre le parti des Droits de l'homme (fondé en juillet
2007 par Khem Sokha, 3 sièges), le nouveau parti de N. Ranariddh – alors
en Malaisie après avoir été condamné pour abus de confiance et évincé
de la direction du Funcinpec – (2 sièges) et ce dernier, désormais
réduit, à la suite de ces dissensions, à deux députés. Après
confirmation des résultats par la Commission nationale des élections,
Hun Sen est reconduit dans ses fonctions. Le prince Ranariddh, gracié,
peut rentrer d'exil.
En octobre 2012, la mort de Norodom Sihanouk,
auquel les Cambodgiens rendent hommage à Phnom Penh pendant trois mois
avant l’organisation des funérailles, clôt un chapitre de l’histoire du
pays.
11.4. Les élections de 2013 et la progression de l’opposition
Le PPC conserve officiellement sa majorité aux élections législatives de juillet 2013, mais réalise son plus mauvais score depuis 1998 avec 68 sièges sur 123 contre 55 au parti du Sauvetage national du Cambodge (CNRP, issu de la fusion en 2012 du PSR et du parti des Droits de l'homme) conduit par S. Rainsy. Condamné pour diffamation en septembre 2010, ce dernier avait pu mettre fin à son exil en France après avoir été gracié par le roi et prendre la tête de l’opposition sans être cependant autorisé à se présenter comme candidat.
Réunissant plusieurs milliers de manifestants dans la
capitale le 26 août puis les 7 et 15 septembre, l’opposition revendique
la victoire avec 63 sièges et exige, en vain, une enquête indépendante
sur les irrégularités supposées du scrutin et le climat d’intimidation
qui l’a entouré, la commission électorale étant accusée d’être inféodée
au pouvoir. Les résultats sont cependant validés par le Conseil
constitutionnel. En obtenant un nombre inattendu de voix, le CNRP
parvient ainsi à ébranler l’hégémonie et la légitimité du parti au
pouvoir. C’est dans un contexte toujours tendu qu’en l’absence des
députés de l’opposition qui boycottent la séance de l’Assemblée, Hun Sen
est investi pour un nouveau mandat le 24 septemtre

0 commentaires:
Enregistrer un commentaire