
Chypre
Capitale: Nicosie
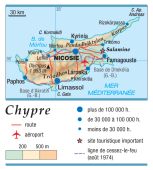
Nom officiel: République de Chypre
Population: 1 172 458 habitants
(est. 2014) (rang dans le monde: 160)
Superficie: 9 250 km. car. (dont 3 355 km. car. dans la zone de Chypre nord)
Système politique république;
note: en 1974, le tiers nord de l’île de Chypre a été occupé par les Forces armées turques; il forme, de facto, un État séparé, appelé depuis 1983 République turque de Chypre du Nord, et reconnu seulement par la Turquie.
Capitale: Nicosie
Monnaie: régions sous le contrôle du gouvernement: euro. Régions sous le contrôle de l'administration turque chypriote: nouvelle lire turque.
PIB (per capita): 24 500$ US (est. 2013).
Langues: grec (langue officielle) 80,9%, turc (langue officielle) 0,2%, anglais 4,1%, roumain 2,9%, russe 2,5%, bulgare 2,2%, arabe 1,2%, philippin 1,1%, autres 4,3%, non spécifié 0,6% (recensement 2011)
Religions: orthodoxes grecs 78%, musulmans 18%, autres (incluant maronites et apostoliques arméniens) 4%
GÉOGRAPHIE
Par sa superficie (9 251 km2), Chypre est la troisième île de la Méditerranée, après la Sicile et la Sardaigne. Située à 75 km au sud de la côte anatolienne, à un peu plus d'une centaine de kilomètres à l'ouest du littoral syrien, à 380 km au nord de la côte égyptienne et à 380 km à l'est de Rhodes (Grèce), elle occupe une position stratégique en Méditerranée orientale. Depuis 1974, elle est partagée entre une partie grecque (environ 60 % du territoire) et une partie turque (35 %). Le reste du territoire chypriote est occupé par les bases militaires britanniques d'Akrotíri et Dhekélia.
Deux chaînes de montagnes séparent une dépression
centrale, site de Nicosie. L'économie, à dominante agricole (agrumes,
vigne, céréales), et le tourisme ont souffert de la partition de fait de
l'île entre communautés grecque (environ 80 % de la population totale)
et turque. Récemment, l'exposition du secteur financier à la crise
grecque et une pénurie énergétique ponctuelle ont aggravé les
difficultés du pays, amené à solliciter, en 2012, l'aide de l'Union
européenne.
1. Les données naturelles
1.1. Les aspects du relief
Chypre comporte trois grandes unités structurales et morphologiques.
La chaîne du Nord (Pendadháktylon), à direction
ouest-est, culmine à 1 024 m d'altitude au Kyparissovouno. Prolongée
dans toute la péninsule nord-orientale du Karpas,
où les altitudes dépassent 1 000 mètres, c'est essentiellement une
arête aiguë de calcaires jurassiques marmoréens, redressés à la
verticale en une série d'écaillés très complexes, avec quelques
intrusions de schistes triasiques et de roches vertes. Il s'agit d'un
élément structural très comparable aux chaînes tauriques de l'Anatolie
méridionale.
Au sud et au sud-ouest de l'île, l'imposante masse du Tróodhos,
qui culmine à 1 953 m, comporte à la périphérie une couronne de
calcaires miocènes montant jusque vers 800 m, qui environnent d'un
abrupt assez continu un noyau constitué par deux intrusions plutoniques
de roches ultrabasiques (serpentine, gabbro), associées à des laves et
des tufs également basiques empilés en une vaste couverture. La zone
sommitale se présente à l'ouest comme une longue arête centrale, avec
arêtes secondaires vers le nord et le sud, au centre comme une lourde
coupole (la montagne étant restée indemne de la sculpture glaciaire
quaternaire), c'est le Tróodhos proprement dit, tandis qu'à l'est la
montagne se fragmente en blocs isolés. Ce contraste exprime l'intensité
plus grande du soulèvement récent vers l'ouest. Sur le flanc sud,
l'enveloppe sédimentaire miocène est découpée en cuestas regardant vers
la montagne. La plaine centrale, la Mésorée,
est une vaste ondulation synclinale où du flysch oligo-miocène s'est
accumulé sur plusieurs kilomètres d'épaisseur. Le Pliocène marin,
discordant sur le Miocène, a encore 700 m d'épaisseur. Le relief est
constitué par une alternance de secteurs pliocènes et de vastes
remblaiements quaternaires de cailloutis entaillés en terrasses dans les
vallées.
La mise en place de ces unités structurales s'est
effectuée en plusieurs phases tectoniques majeures. Celle du Crétacé
supérieur est responsable des grandes intrusions magmatiques du Sud. Les
phases tangentielles tertiaires se situent à l'Éocène et au Miocène
tardif. Les derniers mouvements verticaux, au Quaternaire, ont rajeuni
et mis en place le relief actuel. La tectonique reste encore active, et
les flancs sud-ouest et sud du Tróodhos sont fortement séismiques (grand
tremblement de terre de 1953 notamment).
1.2. Le climat et la végétation

Au point de vue thermique, en effet, la chaîne du
Nord, exposée directement en été aux vents étésiens, joue un rôle de
barrière climatique. Les vents qui la traversent ont sur le versant
intérieur un effet de fœhn et entraînent des variations thermiques
beaucoup plus fortes. L'amplitude diurne est ainsi plus faible sur la
côte septentrionale. Kerýnia y a une moyenne de janvier de 11,9 °C avec
des moyennes de minimums et de maximums respectivement de 9,3 et
14,4 °C, et une moyenne de juillet de 27,4 °C avec des moyennes de
minimums et de maximums de 23,6 et 31,1 °C. Sur la côte méridionale,
Limassol (Lemessós) a la même moyenne de janvier, 11,9 °C, avec des
écarts moyens diurnes plus importants (7,2 et 16,6 °C), et 26,1 °C en
juillet avec des chaleurs diurnes plus fortes (18,8 et 33,3 °C). Quant à
la Mésorée, un caractère continental s'y annonce déjà. Les températures
hivernales y sont moins tièdes, et c'est une véritable fournaise
estivale (Nicosie : 10 °C en janvier avec 5,5 et 14,4 °C de moyennes de
minimums et de maximums ; 28,8 °C en juillet avec 21,1 et 36,6 °C).
Les précipitations restent relativement abondantes
sur la côte septentrionale, bien exposée aux vents pluvieux des
dépressions qui longent la côte sud de l'Anatolie (Kerýnia : 552 mm).
Elles sont nettement plus faibles sur la côte
méridionale (Limassol : 435 mm) et surtout dans la Mésorée (Famagouste :
415 mm ; Nicosie : 335 mm). Elles sont les plus élevées sur les flancs
du Tróodhos (Trikoúkkia, à 1 100 m d'altitude : 875 mm),
particulièrement sur le versant occidental, exposé aux vents pluvieux.
Le paysage végétal porte la marque de l'étagement en
altitude ainsi que de la variété des expositions. La Mésorée est une
steppe. Ailleurs, l'étage inférieur est recouvert à l'état naturel par
une forêt à base de pins (Pinus brutia, ou pin d'Alep), associés aux arbousiers et à une variété de chênes verts propre à l'île, le chêne à feuilles d'aulne (Quercus alnifolia). Au-dessus de 1 000 m domine le pin noir (Pinus nigra).
Mais, dans l'ouest du Tróodhos, beaucoup plus arrosé, se localise un
îlot considérable de forêt humide d'altitude, comportant un vaste
peuplement de cèdres à peu près pur (Cedrus brevifolia, endémique, propre à l'île). L'est de la montagne est au contraire très largement déboisé.
Les espaces théoriquement forestiers s'élèvent à
17 p. 100 de la surface de l'île, mais une assez faible proportion
seulement est composée de véritables forêts, malgré les efforts de
reboisement et de cantonnement des parcours du bétail assidûment
poursuivis depuis la prise de possession britannique de 1878. Cependant
la disparition d'une grande partie des forêts montagnardes exprime
également l'héritage d'une distribution de la population caractérisée
par des accumulations montagnardes, qui porte témoignage de la marque
d'un passé historique complexe.
2. Une île divisée
2.1. La population

Au nord, de nombreux Turcs chypriotes ont
émigré vers le Royaume-Uni, alors qu'arrivaient des Turcs d'Anatolie
venus avec les encouragements des autorités d'Ankara. Aujourd'hui, la
population est estimée à plus de 830 000 personnes (650 000 au sud et
180 000 au nord, dont plusieurs dizaines de milliers de Turcs
d'Anatolie), auxquelles il faut ajouter d'importants contingents
militaires (30 000 Turcs, 3 200 Britanniques, 1 200 Grecs et
1 200 casques bleus des Nations unies).

2.2. Les activités
L'activité agricole est organisée, dans la Mésorée et sur le littoral, autour de l'agrumiculture, des cultures céréalières et maraîchères. Sur les piémonts montagneux dominent les vignobles et les oliveraies, ainsi que l'élevage ovin. Le massif du Tróodhos possède, en outre, une industrie forestière et plusieurs exploitations minières (cuivre, chrome, amiante). L'île paraissait en revanche dépourvue de ressources énergétiques jusqu'à la découverte de vastes gisements maritimes de gaz naturel. Ces gisements recèleraient 1 700 milliards de m3. Ils se situent à proximité de ceux d'Israël et les deux pays ont signé un accord frontalier en 2010 pour délimiter les zones économiques exclusives respectives des deux pays, avant l'exploitation.
L'industrie, en dehors de quelques branches de biens
de consommation, est en difficulté ; notamment la traditionnelle
extraction minière : chrome, fer et surtout cuivre (l'île a donné son
nom à ce métal). L'activité industrielle s'est développée autour de
Nicosie et des ports de Limassol, Lárnaka et Famagouste.
Le secteur des services est en revanche très actif dans la partie sud
de l'île : Chypre est un pavillon de complaisance, accueille des
sociétés étrangères offshores, et le tourisme (culturel et balnéaire)
est le premier poste de l'économie. Le nord de Chypre, quant à lui,
reste très dépendant de l'aide économique de la Turquie,
avec laquelle il réalise l'essentiel de ses échanges. La balance
commerciale est déficitaire, mais ce déficit est en grande partie
compensé par les rentrées en devises liées aux activités de service.
L'entrée de la République de Chypre dans l'Union européenne, en 2004, n'a pas fait aboutir les tentatives de mettre fin à la division de l'île.
HISTOIRE
1. L'Antiquité
L'île se peuple à partir du VIIe millénaire avant J.-C. mais c'est seulement après 2500 avant J.-C. que commence l'exportation de ses richesses, le cuivre et le bois. Au IIe millénaire avant J.-C., Chypre développe son commerce avec l'Égée, l'Égypte et surtout la Syrie. Une écriture, qui n'a pas été déchiffrée, le syllabaire chypro-minoen, apparaît à Engómi (xve siècle avant J.-C. ?). La modeste culture locale se maintient dans le domaine religieux, mais l'art est dominé par les influences de l'Orient et de l'Égée ; l'île ne tarde pas à imiter les vases mycéniens, qu'elle reçoit en abondance après 1400 avant J.-C.
Frappée par un ennemi anonyme (Peuples de la Mer ?), Chypre est ensuite colonisée par des réfugiés du monde mycénien, qui sont à l'origine de la prospérité de l'île, au xiie siècle avant
J.-C. Puis le commerce maritime décline et, après des séismes, les
grandes villes (Engómi, Cition [ou Kition], Paphos) sont abandonnées (xie siècle avant
J.-C.). Faut-il ajouter à ces faits fournis par l'archéologie ce que
l'on sait sur le royaume d'Alashiya, qui pourrait bien se situer à
Chypre ?
Lorsque les « siècles obscurs » (xie-ixe siècle avant
J.-C.) s'achèvent, l'île comprend trois populations, plus ou moins
mêlées et caractérisées par leurs langues : l'étéocypriote (parler
ancien de Chypre), un dialecte grec et le phénicien, apporté par un
mouvement de colonisation depuis le xie siècle.
Il en résulte une culture mixte, ouverte aux influences étrangères,
égyptienne et surtout grecque de l'Égée. L'île est divisée en une
dizaine de royaumes – dont le plus important est celui de Salamine –,
qui subissent les dominations assyrienne (depuis Sargon II), égyptienne
(sous Amasis), perse (525-332 avant J.-C.). Leurs dynasties sont
éliminées par Ptolémée (ive-iiie siècles avant J.-C.).
Sous les Lagides,
Chypre est gouvernée par un stratège résidant à Salamine, puis elle est
plusieurs fois constituée en royaume entre 163 et 50 avant J.-C. Elle
devient province romaine en 58 avant J.-C., mais César la rend aux Ptolémées.
En 27 avant J.-C., l'île est rattachée à la Cilicie ;
en 22 avant J.-C. elle devient province sénatoriale. Maintenue dans
l'empire d'Orient, Chypre résiste longtemps à l'expansion de l'islam.
2. Le Moyen Âge
De la fin du xiie au xve siècle, Chypre est l'une des bases d'attaque des croisés. Conquise par Richard Cœur de Lion lors de la 3e croisade, vendue aux Templiers (1191), puis, après une révolte de la population, à Gui de Lusignan (1192), pour le dédommager de son éviction du trône de Jérusalem, Chypre devient (1197) un royaume dont la civilisation est fortement marquée par l'influence de la France, du fait de l'installation de nombreux nobles français et de la famille royale de Lusignan, originaire du Poitou.
Chypre devient ainsi, aux xiiie et xive siècles,
un État de peuplement, d'économie et de civilisation occidentaux en
Orient, État dont l'importance stratégique est soulignée par
l'installation dans l'île, au xiiie siècle, de l'ordre Teutonique.
Après la perte de Saint-Jean-d'Acre (1291), l'île
devient même le principal centre latin d'Orient. Colons et négociants de
la côte du Levant y refluent, et une période d'une exceptionnelle
prospérité commence pour elle. Le commerce enrichit la colonie génoise
de l'île qui, dès lors qu'elle prête aux rois de Chypre, joue un rôle
politique. En 1383, Jacques Ier doit céder Famagouste aux
Génois et accroître sans cesse les impôts pour satisfaire ses
créanciers, qui constituent une société par actions, la Mahone de Chypre. Pour se dégager de la tutelle génoise, Jacques II (1460-1473) recherche l'alliance de Venise, qui dispose d'un comptoir à Paphos. Il épouse en 1468 une Vénitienne, Catherine Cornaro, qui, après le règne éphémère de son fils Jacques III (1473-1474), gouverne Chypre jusqu'en 1489 et la cède à Venise.
3. De l'occupation britannique à l'indépendance
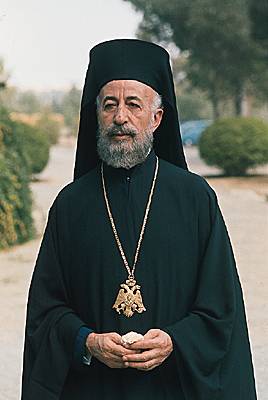
À la suite de troubles, le Conseil législatif est
supprimé en 1931. La Grande-Bretagne propose en 1947 un statut plus
libéral, qui est rejeté par la population, dont la majorité réclame
l'union avec la Grèce, l'Enôsis.
La guerre civile, menée par l'EOKA (Organisation nationale des
combattants chypriotes), sous la direction du colonel Ghrívas, avec
l'appui de l'Église orthodoxe autocéphale de l'île (représentée par
l'archevêque Makários),
n'aboutit finalement pas à l'Enôsis, mais à l'indépendance et à la
proclamation de la république, à la suite des accords helléno-turc de
Zurich (11 février 1959) et anglo-helléno-turc de Londres (19 février
1959). Cette décision, qui sera mise en application dans un délai de
deux ans, tient compte des intérêts stratégiques anglais en Méditerranée
orientale et de l'existence d'une minorité turque dans l'île : la
Grande-Bretagne conservera des bases militaires à Chypre, et l'État
chypriote sera dirigé par un président grec (Monseigneur Makários, élu
le 14 décembre 1959) et par un vice-président turc (Fazil Küçük).
4. Violences intercommunautaires et partition de l'île
Toutefois, de graves incidents opposant les deux communautés (1963, 1965, 1967), le mandat des forces internationales à Chypre est prolongé. Réélu en 1968, Monseigneur Makários accepte que s'ouvrent des négociations entre les deux communautés, mais le conflit se durcit et se double d'une tension entre Nicosie et Athènes, qui soutient l'action de Ghrívas, partisan de l'Enôsis. La réélection de Makários (1973) et la mort de Ghrívas (1974) ne font qu'aggraver la situation.
Le 15 juillet 1974, Makários est renversé par un coup
d'État de la garde nationale, qui instaure un gouvernement favorable à
l'Enôsis ; le 20 juillet, la Turquie réplique en opérant un débarquement
de force à Kerýnia. La médiation britannique et la chute, en Grèce, du
régime des colonels permettent, le 30 juillet, à Genève, la signature
d'un accord tripartite, qui aboutit à un cessez-le-feu. Les négociations
qui s'ouvrent alors sont interrompues par une nouvelle intervention
militaire turque (14 août 1974), que suit un massif exode de la
population grecque vers le sud de l'île. Le nouveau président grec de
Chypre, Gláfkos Klirídhis (Glafcos Cléridès), et le vice-président turc, Rauf Denktaş,
organisent de nouveaux entretiens intercommunautaires ; mais le retour à
Nicosie de Monseigneur Makários (décembre 1974) remet tout en question.
Le 13 février 1975, les Chypriotes turcs proclament unilatéralement que
leur territoire, situé au nord de la « ligne Attila » – qui relie
Kókkina, Léfka, Nicosie et Famagouste –, constitue un « État autonome,
laïque et fédéré », dirigé par R. Denktaş.
Au début de 1977, des négociations reprennent entre
ce dernier et Monseigneur Makários ; mais celui-ci meurt le 3 août. Il
est remplacé à la tête de l'État chypriote grec par le président de
l'Assemblée nationale, Spýros Kyprianoú, qui refuse de reconnaître la
partition de l'île. Celle-ci est cependant consacrée par la création, en
novembre 1983, d'un État chypriote turc indépendant, la « République
turque de Chypre du Nord » (RTCN), présidée par Rauf Denktaş. En dépit
de la reprise de nouvelles négociations en 1984-1985, les deux
communautés ne parviennent pas à s'entendre sur un règlement
institutionnel.
En février 1988, Gheórghios Vassilíou est élu
président de la République de Chypre ; Ghláfkos Klirídhis lui succède en
février 1993. Ces changements à la tête de l'État n'empêchent cependant
pas une grande stabilité politique : le Rassemblement démocratique et
le parti démocrate conservent la majorité parlementaire face aux partis
communiste et socialiste. De même, en RTCN, R. Denktaş est régulièrement
réélu avec le soutien du parti de l'Unité nationale et du parti
démocratique.
5. Intégration européenne et tensions régionales
La stabilité des vies politiques intérieures de la République de Chypre et de la RTCN contraste avec la précarité de leurs relations mutuelles et les transformations rapides de leur environnement régional. De ce point de vue, l'évolution la plus importante est l'amorce d'un processus d'intégration de la République de Chypre au sein de la Communauté européenne. Après avoir signé un premier accord d'union douanière (1988), la République de Chypre dépose officiellement sa demande d'adhésion à la Communauté européenne en juillet 1990.
Ce processus d'intégration réveille les tensions
gréco-turques. La Communauté européenne souhaite en effet que l'adhésion
de Chypre soit précédée d'un compromis institutionnel entre les deux
communautés de l'île. Mais la Grèce refuse de faire de ce préalable une
condition sine qua non, cependant que la RTCN menace de proclamer
son indépendance définitive si Chypre intègre la Communauté européenne
avant la Turquie. C'est dans ce contexte instable que de graves
incidents sur la ligne de séparation (août 1996), puis la commande de
missiles russes par la République de Chypre (janvier 1997) font
ressurgir le péril d'un affrontement gréco-turc majeur autour de la
question chypriote.
5.1. Le « non » des Chypriotes grecs à la réunification de l'île (24 avril 2004)
Le 30 mars 1998, les négociations en vue de l'adhésion de la République de Chypre à l'Union européenne sont officiellement ouvertes, les Chypriotes grecs obtenant de Bruxelles la promesse d'être accueillis quelle que soit la situation sur l'île. En 2002, les deux dirigeants chypriotes entament, en janvier, des négociations en vue de la réunification de l'île sous l'égide des Nations unies, puis en novembre, le secrétaire général Kofi Annan présente au Conseil de sécurité un plan institutionnel proposant la réunification de Chypre en un seul pays sous gouvernement fédéral, composé de deux États égaux, qui seraient administrés de façon largement autonome par les deux communautés. Aucun accord n'étant intervenu entre Tássos Papadhópoulos (élu en février à la présidence grecque) et R. Denktaş, – ce dernier ayant refusé la tenue d'un référendum sur le plan de paix dans les deux parties de l'île, ainsi que le proposait, en dernier recours, K. Annan –, les négociations de paix échouent en mars 2003. Critiquées par leur propre population, qui aspire à prendre le train de l'adhésion offert à la partie grecque lors du sommet européen de Copenhague les 12 et 13 décembre 2002, les autorités chypriotes turques autorisent, en avril 2003, l'ouverture de la « ligne Attila », que franchissent des milliers de Chypriotes, grecs et turcs. Peu après, le gouvernement chypriote grec allège l'embargo commercial frappant la partie turque.
En janvier 2004, un mois après des élections
législatives qui se sont soldées par une égalité de sièges entre
partisans et adversaires d'une réunification de l'île, la RTCN se dote
d'un gouvernement de coalition, dirigé par Mehmet Ali Talat, dans le but
de parvenir à une solution sur la réunification de l'île avant le 1er mai.
Cependant, lors des référendums du 24 avril, les Chypriotes grecs
rejettent le plan de réunification proposé par l'ONU à 75 %, tandis que
les Chypriotes turcs l'approuvent à 65 %. Le « non » de Nicosie rend
caduc le plan Annan et entraîne l'adhésion de la seule partie chypriote
grecque à l'UE le 1er mai. Outre le grave échec que constitue
le maintien de la partition pour celle-ci, le « non » soulève de
nombreux problèmes juridiques, notamment celui de la gestion de la ligne
de démarcation, l'organisation de la circulation des personnes et des
biens entre le Nord et le Sud. Lors des premières élections européennes
organisées en juin dans la partie grecque, les formations, qui s'étaient
opposées au plan onusien de réunification, obtiennent quatre des six
sièges à pourvoir.
5.2. Les obstacles à la reprise des négociations

Le 1er janvier 2008, la République de Chypre, ainsi que Malte,
est autorisée à intégrer la zone euro. L'élection à la présidence
(février) du communiste Dhimítris Khristófias, partisan d'une reprise
des pourparlers, relance les espoirs d'une réunification.
Quatre ans après l'échec du « plan Annan », les
négociations directes reprennent en septembre 2008 sous l'égide des
Nations unies. Mais les élections législatives anticipées d'avril 2009
marquent le retour, en RTCN, de la vieille garde nationaliste du parti
de l'Unité nationale, qui obtient 44,1 % des suffrages devant le CTP du
président Talat (29 % des voix). Ce dernier, engagé dans de difficiles
pourparlers avec le président chypriote grec D. Khristófias, doit
désormais cohabiter avec le chef du gouvernement, Derviş Eroğlu, Premier
ministre de 1985 à 1994 et de 1996 à 2004, et partisan de deux États
distincts. Un an plus tard (avril 2010), la victoire de ce dernier dès
le premier tour l'élection présidentielle avec 50,38 % des suffrages
devant le président sortant, M. Talat (42,85 % des voix) remet
sérieusement en cause les négociations entamées en 2008. Celles-ci ne
sont pourtant pas abandonnées mais piétinent.
Les élections législatives de mai 2011 en République
de Chypre ne changent pas l’équilibre politique même si les
conservateurs du principal parti d'opposition (DISY) arrivent en tête du
scrutin légèrement devant le parti progressiste des Masses laborieuses
(AKEL) au pouvoir. Un gouvernement minoritaire doit cependant être formé
à la suite du retrait du parti démocrate (DIKO) de la coalition
gouvernementale en août 2011, en raison, notamment, de divergences sur
les discussions en vue de la création d’une fédération « bizonale et
bicommunautaire ».
Ces dernières se soldent par une nouvelle impasse en
2012. Outre les questions litigieuses internes – comme celle des
propriétés grecques dans la partie turque ou le partage du pouvoir – et
l’opposition entre les deux parties quant à l’opportunité d’une
conférence internationale, la fermeté de la Turquie (et son peu
d’empressement pour faciliter un accord depuis le ralentissement des
négociations d’adhésion à l’UE) est un sérieux facteur extérieur de
blocage. Un désaccord supplémentaire sur l’exploitation des réserves
gazières récemment découvertes au large de la côte méridionale de l’île
vient par ailleurs aggraver ces tensions. Les négociations doivent
finalement être gelées pendant la première présidence tournante de l’UE
assurée par Chypre, qui débute en juillet 2012.
5.3. Crise économique et victoire des conservateurs
En février 2013, Níkos Anastasiádis, candidat proeuropéen de la droite conservatrice et chef du DISY depuis 1997, remporte l’élection présidentielle avec plus de 57 % des suffrages face à Stavros Malas, soutenu par les communistes. Mais il prend la tête d’un État au bord de la faillite, en raison notamment de la forte exposition du système bancaire à la restructuration de la dette grecque, et surdimensionné par rapport à l’économie de l’île. Alors que son prédécesseur avait refusé les privatisations et les coupes budgétaires comme conditions d’un renflouement international et que le candidat de la gauche avait promis d’atténuer les effets sociaux de la politique de rigueur exigée par l’UE, le nouveau président s’engage dans une difficile négociation avec l’Eurogroupe en vue d’obtenir une aide financière évaluée à 17 milliards d’euros, soit environ l’équivalent du PIB du pays.
Après de longues tractations, d’importantes
manifestations des épargnants contre un premier plan de sauvetage
prévoyant une taxation générale des dépôts bancaires et les pressions
exercées par la BCE, l’île obtient finalement une aide d’un montant de
10 milliards d’euros. En échange de cette assistance, fournie pour
l’essentiel par le Mécanisme européen de stabilité (MES), une
restructuration profonde du système bancaire est adoptée moyennant une
importante ponction sur les dépôts supérieurs à 100 000 euros et une
restriction temporaire des mouvements de capitaux. À la recapitalisation
de la Bank of Cyprus accompagnée par le démantèlement de la banque
Laïki (la deuxième du pays), s’ajoute notamment un renforcement de la
supervision du secteur, dont les banques coopératives, par la Banque
centrale. Le gouvernement s’engage également à augmenter l’impôt sur les
sociétés et à mettre en place un programme de lutte contre le
blanchiment d’argent. En outre, le programme prévoit d’autres hausses
fiscales et des restrictions budgétaires en vue d’une réduction du
déficit public et de la dette de l’État. Alors que la forte récession
s’accompagne d’une hausse du chômage (plus de 17 %), une reprise n’est
pas attendue avant 2015

0 commentaires:
Enregistrer un commentaire