
La Corée du Sud
Capitale: Séoul
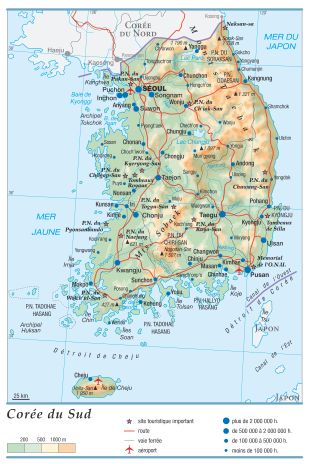
Nom officiel: République de Corée
Population: 49 030 986 habitants (est. 2014) (rang dans le monde: 25)
Superficie: 98 480 km. car.
Système politique: république
Capitale: Séoul
Monnaie: won sud-coréen
PIB (per capita): 33 200$ US (est. 2013)
Langue: coréen
Religions: chrétiens 31,6%, (protestants 24%, catholiques romains 7,6%), bouddhistes 24,2%, autres ou inconnu 0,9%, aucune 43,3% (recensement 2010)
GÉOGRAPHIE
Moins étendu que la Corée du Nord, cet État est beaucoup plus peuplé. L'extension des plaines et des collines et un climat plus doux expliquent la prédominance de la culture du riz. La pêche est aussi active. Palliant la pauvreté du sous-sol, l'abondance de la main-d'œuvre et les capitaux étrangers ont stimulé l'industrie (textile, chimie, sidérurgie et surtout construction navale et automobile, constructions électriques et électroniques). Cette industrie, représentée notamment dans les grandes villes de Pusan (débouché maritime) et de Séoul, est largement exportatrice. Après une phase de croissance spectaculaire, l'économie sud-coréenne s'est trouvée fragilisée par plusieurs crises (régionale en 1997-1998, mondiale en 2007-2008) mais elle reste très dynamique.1. Un relief cloisonné

2. Une population en pleine transition démographique
La population, de 47,2 millions d'habitants (2001), est dense (475 habitants par km2), d'autant plus qu'elle n'occupe que 20 % du territoire (plaines littorales et bassins intérieurs essentiellement), constitué pour le reste de montagnes et de forêts. La Corée du Sud est en pleine transition démographique, ce qui est normal pour un pays qui s'industrialise seulement depuis le début des années 1960 et dont la population est devenue urbaine à 80 % (1999). La natalité est assez faible (15 ‰) et la mortalité est tombée à 6,2 ‰. Avec un taux de fécondité de 1,5 enfant par femme, l'accroissement naturel s'est ralenti et la population a commencé à vieillir. Les moins de 25 ans représentent encore 21 % de la population et les plus de 65 ans, 6 %. L'espérance de vie est de 76 ans : les marques de la pauvreté des années de guerre et de l'immédiat après-guerre sont de moins en moins sensibles.
Le décollage économique sud-coréen ne date, en effet,
que de 1961, avec l'arrivée au pouvoir de Park Chung-hee et le
lancement, en 1962, du premier plan quinquennal. Entre 1961 et 1989, le
P.N.B. sud-coréen en dollars courants a été multiplié par 75. En 1997,
il a dépassé les 476 milliards de dollars, soit 10 155 dollars par
habitant et par an, mais a chuté en 1998 à 321 milliards de dollars,
avant de remonter légèrement l'année suivante à 398 milliards de
dollars. La Corée du Sud est devenue l'un des principaux « dragons
asiatiques », son P.I.B. la situant au 13e rang mondial. En
revanche, si l'on établit l'indice de développement humain, suivant les
paramètres proposés par l'Indien Amartya Sen – prix Nobel d'économie en
1998 –, le pays rétrograde à la 29e place, ce mode de calcul soulignant bien la fragilité du succès sud-coréen.
3. La révolution industrielle sud-coréenne

C'est le secteur secondaire – l'industrie, avec 28 %
des emplois actifs et 43 % du P.I.B. – et le secteur tertiaire – les
services, avec 60 % des emplois et 50 % du P.I.B. – qui ont assuré la
spectaculaire croissance du pays. Cette dernière s'est maintenue dans le
secteur tertiaire autour de 8,9 % par an. Dans l'industrie, elle s'est
située à 14,4 % entre 1962 et 1966, puis entre 18 et 20 % pendant les
deuxième et troisième plans quinquennaux (1967-1976) ; elle est retombée
autour de 10 % entre 1977 et 1986 pour dépasser à nouveau les 15 % par
la suite. Sixième producteur mondial d'acier et d'automobiles, la Corée
du Sud occupe le deuxième rang pour les constructions navales. Elle est
également l'un des grands fabricants mondiaux de semi-conducteurs. La
qualité de sa main-d'œuvre, due à un système d'éducation efficace (la
Corée du Sud compte seulement 2 % d'illettrés, et 52 % des diplômés du
secondaire vont à l'université), est pour beaucoup dans ces succès.
Autre facteur décisif : le système qualifié de « modèle capitaliste
d'État », reposant sur une vingtaine de puissants conglomérats, les chaebols
– Hyundai, Samsung, Daewoo, Lucky Goldstar, Kia, etc. –, qui
structurent les activités économiques à leur profit, avec l'aide de la
puissance publique. Ces entreprises familiales possèdent des milliers de
filiales, emploient des dizaines de milliers de salariés, et leurs
liens multiples avec le monde politique leur ont permis de bénéficier de
crédits bancaires quasi illimités, notamment durant les longues années
de dictature militaire. Certaines d'entre elles sont parties à la
conquête du monde, avec des succès initiaux spectaculaires et quelques
échecs : Hyundai s'est associée à McDonnell-Douglas, en 1995, pour la
construction d'un avion de 100 places, Samsung a tenté de racheter
Fokker, et Daewoo Electronics s'est porté acquéreur de Thomson
Multimédia. La quasi-inexistence de politique sociale semblait, jusqu'à
ces dernières années, ne pas poser de problème : groupés dans une
puissante centrale syndicale officielle, qu'aiguillonne une centrale
concurrente non reconnue, mais très active, les ouvriers, profitant
d'une relative libéralisation du régime, ont obtenu par la grève et la
négociation des hausses de salaire de 15 % durant les années 1990. La
conjoncture était alors favorable aux salariés, le chômage représentant
moins de 3 % des actifs et l'inflation, de 5 %, encourageant le recours
au crédit – ce qui soutenait la consommation intérieure. En 1999,
Daewoo, l'un des grands conglomérats (ou chaebols), symboles de la réussite économique du pays pendant ses « trente glorieuses » a rejoint le giron de General Motors.
4. Une croissance retrouvée
Après une période de restructuration industrielle et après avoir été fragilisée par la crise régionale de 1997-1998, la Corée du Sud a retrouvé, dans les années 2000, un rythme élevé de croissance. En 2007, les quatre principaux conglomérats sont Samsung (électronique), LG (électronique, téléphonie mobile), SK (industrie, chimie, télécommunications) et Hyundai (resté aujourd'hui le seul constructeur de voitures du pays).
De nouveau fragilisée par la crise mondiale en 2007-2008, l'économie sud-coréenne conserve un dynamisme remarquable.
HISTOIRE
La Corée de l'Antiquité à 1953
→ Corée.L'ère Park Chung-hee
Après la signature de l'armistice (27 juillet 1953), la Corée du Sud sort très affaiblie de la guerre et voit s'échapper l'espoir de la réunification. L'aide financière américaine, souvent détournée de son objet, ne parvient pas à sortir le pays de ses difficultés. Parallèlement, les méthodes autoritaires de Syngman Rhee (Lee Sung-man) lui attirent l'inimitié de la population. Réélu en mars 1960, il est renversé un mois plus tard à la suite d'émeutes d'étudiants et doit quitter le pays. Une nouvelle Constitution, de caractère parlementaire, est élaborée, donnant naissance à la IIe République.
Toutefois, ni le nouveau président, Yun Po-son, ni le
Premier ministre, Chang Myon, ne peuvent réaliser l'unité indispensable
au redressement du pays. La dégradation de la situation incite une
junte militaire à s'emparer du pouvoir (16 mai 1961). Le gouvernement
Chang doit démissionner, mais Yun Po-son est maintenu dans ses
fonctions. Le chef de la junte, puis du gouvernement, Chang Do-yon, ne
garde le pouvoir que cinquante jours. Il est remplacé par le général Park Chung-hee
(Pak Chong-hui), qui consolide peu à peu son pouvoir et fait approuver
en décembre 1962 l'établissement d'un régime présidentiel. Après avoir
démissionné de l'armée, Park Chung-hee se présente à l'élection
présidentielle et, grâce aux divisions de l'opposition, est élu
(décembre 1963). Pour former le gouvernement, il s'appuie sur le parti
démocratique républicain, qui emporte 110 sièges sur 175 aux élections
de novembre 1963.
Sur le plan extérieur, le 21 février 1965, un traité
est signé à Séoul entre la Corée et le Japon. Ce traité, qui normalise
les relations entre les deux pays, suscite une vive agitation, en
particulier chez les étudiants. Au début de cette même année, la Corée
envoie un premier contingent de 2 000 hommes au Viêt Nam du Sud.
Mais, à l'intérieur, les difficultés s'accroissent.
Un nouveau parti démocrate est créé le 7 février 1967, qui a pour leader
Yun Po-son. Le gouvernement procède à l'arrestation arbitraire d'une
centaine de membres de l'opposition. En mai 1967, Park Chung-hee est
pourtant réélu à la présidence de la République avec une confortable
majorité. Les élections législatives suivantes assurent à son parti les
trois quarts des sièges à la Chambre des représentants. Les fraudes,
lors de ces élections, suscitent une vive agitation qui incite le
président à exclure du parti gouvernemental plusieurs députés
irrégulièrement élus. En novembre 1967 a lieu le procès d'opposants qui
ont été enlevés par les services secrets sud-coréens en juin dans
plusieurs pays étrangers, en particulier en Allemagne de l'Ouest et en
France, ce qui soulève des difficultés avec ces deux pays. Le
14 septembre 1969, le président Park Chung-hee fait adopter par le
Parlement, en l'absence de l'opposition, un amendement constitutionnel
lui permettant de solliciter un troisième mandat présidentiel. Un
référendum (17 octobre 1969) consacre sa victoire. Le 27 avril 1971, il
est réélu à la présidence de la République malgré la campagne de Kim Dae-jung,
principal candidat de l'opposition. Un mois plus tard, son parti
remporte les élections législatives. Bien que Park Chung-hee décrète, le
6 décembre 1971, l'état d'urgence pour prévenir une invasion nordiste
et repousse, en janvier 1972, un traité de paix, les négociations avec
Pyongyang se poursuivent et aboutissent, le 4 juillet 1972, à un accord
qui met fin à l'état de belligérance. Interrompues par la suite à
plusieurs reprises, ces négociations n'auront guère de résultats
concrets. Le 17 octobre 1972, le président Park proclame la loi martiale
pour réformer les structures politiques, suspend la Constitution,
dissout l'Assemblée nationale et interdit les activités des partis
politiques. Une nouvelle Constitution, dite « du renouveau », qui
accorde au président un pouvoir considérable et lui permet de créer une
Conférence nationale pour la réunification placée au-dessus du
Parlement, est massivement approuvée par référendum le 21 novembre 1972.
La nouvelle Assemblée nationale, dominée par le parti républicain du
Peuple, tient sa séance d'ouverture le 12 mars 1973. Kim Jong-pil est
élu Premier ministre. Face au développement de l'opposition, le
gouvernement engage à partir de janvier 1974 une politique de répression
(multiplication des procès politiques, publication de décrets
d'exception, arrestation de Kim Dae-jung au Japon). En février 1975, le
président Park organise un référendum destiné à cautionner sa politique.
Les élections de 1978 lui confient un nouveau mandat. Cependant, la
« démocratie dirigée » devient de plus en plus pesante à une population
dont la liberté est limitée au nom du développement économique, par
ailleurs remarquable à bien des égards, et de la lutte anticommuniste.
Park Chung-hee est assassiné le 26 octobre 1979 par Kim Chae-kyu,
directeur du service central de renseignements.
La lente libéralisation du régime, dans un contexte de crise
Choe Kyu-ha, qui avait remplacé Kim Jong-pil comme Premier ministre (décembre 1975), est élu président de la République (décembre 1979).
L'assassinat de Park Chung-hee confirme que, en 1979,
malgré un décollage économique qui durait depuis près de deux décennies
et qui avait permis la naissance d'une classe moyenne désireuse de
libertés et de garanties contre l'arbitraire, les vieux démons habitent
toujours les sphères du pouvoir, accaparé par des politiciens et des
militaires corrompus, entourés de leurs clients et de leurs hommes de
main. En mai 1980, à Kwangju, des manifestations d'étudiants pour la
démocratie sont écrasées dans le sang par l'armée et la police politique
du président Choe Kyu-ha. Sous la présidence du général Chun Doo-hwan, élu en août 1980, puis du général Roh Tae-woo
– le premier à être élu au suffrage universel, en décembre 1987, avec
36,6 % des voix –, une évolution s'amorce. Elle se précise, en 1990,
avec la création d'un parti démocrate-libéral, inspiré du modèle
japonais, qui unit Roh Tae-woo à l'opposant de toujours aux militaires,
Kim Young-sam, et au centriste Kim Jong-pil, hommes proches des milieux
d'affaires et des Japonais. La signature en 1991 d'un pacte de
non-agression et de réconciliation entre les deux Corées, dans la foulée
de leur admission à l'ONU, est toutefois suivie d'une détérioration de
leurs relations dès l'année suivante. En 1992, Kim Young-sam
devient président de la République. Il cherche à mettre en pratique, en
1993, son programme électoral de démocratisation et d'épuration :
3 000 politiciens sont traduits en justice ; les deux anciens présidents
Chun Doo-hwan et Roh Tae-woo sont envoyés en prison pour malversations
– ce dernier reconnaissant avoir détourné 650 millions de dollars
pendant son mandat. Cependant, le président Kim Young-sam est lui aussi
éclaboussé par le scandale. Un nouveau président, Kim Dae-jung,
autre opposant de toujours aux militaires, est élu en décembre 1997 sur
un programme de lutte contre la corruption. Il est aussitôt confronté à
la crise asiatique et doit faire face aux tensions sociales aiguës et à
la résistance des chaebols aux démantèlements sectoriels. Malgré
sa forte progression, le parti démocrate du Millénaire (PDM) – le parti
du président – est devancé, aux élections législatives de 2000, par le
principal parti d'opposition, le grand parti de la Nation (GPN), ce qui
le contraint à trouver des alliés pour la formation d'un nouveau
gouvernement.
Les tentatives de rapprochement avec la Corée du Nord

L'élection présidentielle du 19 décembre 2002 – qui
se déroule dans un contexte régional très tendu à la suite de la
décision de la Corée du Nord de relancer son programme nucléaire – est
remportée par le candidat du PDM, Roh Moo-hyun
(48,9 % des voix). Cet ancien avocat, défenseur des droits de l'homme,
se montre soucieux de promouvoir une meilleure justice sociale. Mais
après une courte période de grâce et malgré une réelle volonté de
réforme, le président ne parvient pas à mettre en œuvre les mesures
nécessaires, combattues par l'opposition majoritaire à l'Assemblée.
Fragilisé par les scandales touchant certains de ses proches
collaborateurs et par une chute de sa cote de popularité, isolé sur la
scène parlementaire à la suite d'une scission du PDM (qu'il a lui-même
quitté en septembre), Roh Moo-hyun est destitué le 12 mars 2004 par le
Parlement pour « infraction à la loi électorale » : ayant rallié le GPN à
son offensive, le PDM accuse le chef de l'État d'avoir apporté son
soutien en période électorale au nouveau parti progressiste Uri, formé
en 2003 de dissidents du PDM. Dans l'attente d'une décision de la Cour
constitutionnelle, le président est remplacé par le Premier ministre
Goh Kun ; ses partisans organisent des manifestations de protestation et
qualifient cette destitution de « coup d'État ». Les élections
législatives du 15 avril sont remportées par le parti Uri, qui, avec
152 députés sur 299, détient la majorité absolue ; le GPN n'a plus que
121 sièges, tandis que le PDM, passant de 61 sièges à 9, est laminé ; le
parti démocrate du Travail, une petite formation de gauche, obtient
10 sièges et devient la troisième formation politique du pays. Le
14 mai, Roh Moo-hyun est rétabli dans ses fonctions de chef de l'État
par la Cour consitutionnelle. En avril 2006, la nomination d'une femme à
la tête du gouvernement – une première dans l'histoire du pays – ne
parvient pas à enrayer le déclin du soutien au président. En proie à de
fortes tensions internes entraînant plusieurs défections dans ses rangs,
le parti Uri perd la majorité à l'Assemblée aux élections locales de
mai ; la mise en œuvre des réformes est compromise.
Sur le plan extérieur, Roh Moo-hyun poursuit la politique de rapprochement avec la Corée du Nord initiée par son prédécesseur, Kim Dae-jung.
Baptisée « politique de paix et de prospérité », elle se traduit par de
réelles avancées telles qu'une aide humanitaire bilatérale, la création
de la zone industrielle de Kaesong (Corée du Nord) rassemblant
travailleurs Nord- et Sud-coréens (2003), l'établissement d'une ligne
téléphonique directe entre les deux pays ou encore la célébration
conjointe de leur libération de la colonisation japonaise (août 2005).
Séoul lie, notamment, tout nouveau projet de coopération à des progrès
dans le processus de règlement de la crise nucléaire nord-coréenne
engagé depuis août 2003 à l'initiative de la Chine et réunissant, outre
les deux Corées, les États-Unis, la Russie, le Japon et la Chine.
Condamné par la résolution 1718 du Conseil de sécurité de l'ONU, l'essai
nucléaire nord-coréen du 9 octobre 2006 porte un coup sérieux la
politique de réconcilation intercoréenne. Séoul se résout à sanctionner
son voisin du Nord. Simultanément, la nomination de Ban Ki-moon, un des artisans de l'ouverture à la Corée du Nord, au poste de secrétaire général de l'ONU,
apparaît comme un signe de bonne augure. Accueillant favorablement
l'accord conclu le 13 février 2007 dans le cadre des « pourparlers à
six » et par lequel Pyongyang s'engage à désactiver son programme
nucléaire (notamment sa centrale de Yongbyon), Séoul reprend son aide,
énergétique et humanitaire.
Les relations avec les États-Unis, l'allié
historique, connaissent des tensions. Outre les divergences profondes
entre Washington et Séoul vis-à-vis de Pyongyang, se fait jour le désir
d'une plus large autonomie de décision de la part du gouvernement
sud-coréen. Celui-ci s’emploie, notamment, à conclure des négociations
sur la récupération du commandement militaire sur les troupes
américaines basées en Corée du Sud en cas de guerre dans la péninsule.
De leur côté, les États-Unis procèdent au retrait partiel et planifié de
leurs troupes. Les relations avec le Japon pâtissent de la résurgence
de différends hérités du passé : la revendication de part et d'autre des
îles Tokdo, la mise à jour de manuels scolaires nippons édulcorant les
violences infligées aux Coréens durant l'occupation japonaise ou encore
les pèlerinages répétés du Premier ministre Junichiro Koizumi au sanctuaire de Yasukuni, où sont honorés des criminels de guerre.
Pour en savoir plus, voir l'article histoire du Japon.
L'alternance politique

Les premières décisions du nouveau chef de l'État, et
notamment la réouverture du marché sud-coréen aux importations de
viande de bœuf américain (suspendues en 2003 à la suite de l'apparition
de plusieurs cas de maladie de la vache folle) provoquent, en mai, une
vague de protestations dans tout le pays, et le 10 juin, la démission en
bloc du gouvernement de Han Seung-soo qui procède à un remaniement
ministériel. Alors que sa popularité est en forte chute, le président
doit faire face fin 2008 à la crise économique internationale, qui
touche de plein fouet la Corée, victime notamment d'une chute de ses
exportations et d'une forte baisse de sa monnaie, et à une crise
politique intérieure. En effet, ne disposant que de 87 sièges sur 299 à
l'Assemblée, le Parti démocratique (à la tête d’une opposition
recomposée après la dissolution du parti Uri) engage un véritable siège
de la chambre, occupant notamment le bureau de son président pendant
15 jours, pour tenter d'empêcher l'adoption de 85 mesures, parmi
lesquelles figurent la ratification du traité de libre-échange avec les
États-Unis, l'interdiction des plaintes collectives ou la décision de
recourir à la prison ferme pour les internautes reconnus coupables de
diffamation. En août 2010, après le bref intermède du Premier ministre
Chung Un-chan (septembre 2009-juillet 2010) et un revers du GPN aux
élections locales en juin (conforté toutefois à l’Assemblée à la suite
d’élections partielles), un remaniement gouvernemental d’envergure est
décidé par le président Lee mais 3 titulaires, dont le Premier ministre
et le ministre des Affaires étrangères, ne présentant pas les garanties
d’intégrité exigées sont écartés lors des auditions parlementaires.
C’est finalement Kim Hwang-sik, président de la Cour de Comptes et
ancien juge de la Cour Suprême qui prend la tête du gouvernement en
octobre après avoir obtenu l’approbation de l’Assemblée nationale.
À l’issue des élections législatives d’avril 2012
remportées de justesse par le GPN (rebaptisé parti de la Nouvelle
Frontière), alors que l’opposition menée par le parti démocratique
unifié progresse de 46 sièges, le Premier ministre sortant est reconduit
dans ses fonctions. L’une des premières mesures du gouvernement est la
mise en application de l’accord de libre échange signé en mars avec les
États-Unis tandis qu’une libéralisation des échanges avec la Chine et le
Japon est également prônée.
Sur le plan international, la situation se tend entre
la Corée du Sud et ses voisins japonais et coréen du Nord. Ainsi, en
juillet 2008, ripostant à la recommandation du ministère japonais de
l'Éducation de mentionner dans les manuels scolaires comme faisant
parties du territoire nippon les îles – baptisées Takeshima au Japon,
Dokdo en Corée du Sud –, la Corée du Sud rappelle son ambassadeur à
Tokyo et annonce vouloir renoncer au principe d'une « diplomatie
apaisée » avec son voisin. Vis-à-vis de la Corée du Nord, l'arrivée au
pouvoir de Lee Myung-bak se traduit par l'arrêt de la politique de
rapprochement menée par ses prédécesseurs de centre gauche, avec la
nomination d'un partisan de la ligne dure, Hyun In-taek, au poste de
ministre de l'Unification. En réaction, la Corée du Nord annonce en
janvier 2009 qu'elle met fin à tous les accords passés avec la Corée du
Sud, en 2000 et 2007, et au pacte de non-agression et de réconciliation
de 1991. En 2010, les relations entre les deux pays se détériorent
encore à la suite du torpillage (en mars) d’un navire de guerre
sud-coréen par un sous-marin nord-coréen, une « attaque » niée par
Pyongyang mais condamnée à l’unanimité – sans être attribuée
officiellement à la Corée du Nord – par le Conseil de sécurité de l’ONU.
La mort de Kim Jong-il
en décembre 2011 et l’accession au pouvoir de son fils Kim Jong-un
ouvre une nouvelle phase très incertaine dans les relations
intercoréennes. Après une tentative ratée en avril 2012, le lancement
réussi d’un satellite nord-coréen en décembre – qui serait en fait un
essai de tir déguisé de missile balistique intercontinental – puis
l’annonce triomphale d’un troisième test nucléaire le 12 février 2013,
ravivent les tensions entre les deux pays.
C’est dans ce contexte que Park Geun-hye, fille de
l’ancien président Park Chung-hee et candidate du parti de la Nouvelle
Frontière, est élue à la présidence de la République avec 51,6 % des
voix devant Moon Jae-in du parti démocratique unifié. Première femme à
accéder à ce poste, la présidente entre en fonctions le 25 février et
nomme Chung Hong-won, ancien procureur de la République, à la tête du
gouvernement.

0 commentaires:
Enregistrer un commentaire