
La Colombie
Capitale: Bogota
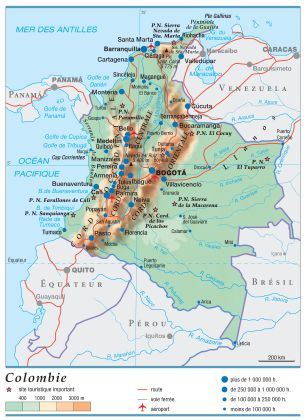
Nom officiel: République de Colombie
Population: 46 245 297 habitants (est. 2014) (rang dans le monde: 28)
Superficie: 1 138 910 km. car.
Système politique: république
Capitale: Bogota
Monnaie: peso colombien
PIB (per capita): 11 100$ US (est. 2013)
Langue: espagnol
Religions: catholiques romains 90%, autres 10%
GÉOGRAPHIE
Le nord des Andes, entaillé par le Cauca et le Magdalena, qui délimitent de hauts plateaux, sépare le littoral, marécageux et insalubre, de l'Est amazonien, couvert de forêts et de savanes. La population en accroissement rapide, où les métis dominent, se concentre dans la région andine, partie vitale du pays. L'agriculture s'étage ici en fonction de l'altitude : coton, canne à sucre, riz et surtout café, principal produit d'exportation, au-dessous de 2 000 m ; céréales et élevage bovin jusqu'à plus de 3 000 m. Le sous-sol fournit surtout du pétrole et du charbon. Lourdement endetté, le pays peine aussi pour résoudre le problème de la production et du commerce de la drogue. La Colombie réalise une part notable de son commerce extérieur avec les États-Unis, par les ports de Buenaventura, Cartagena et Barranquilla (quatrième ville du pays, après Bogotá, Medellín et Cali).1. Les milieux naturels
Le territoire s'étend sur 2 500 km du nord au sud, depuis l'Amazonie jusqu'aux îles Caraïbes de San Andrés et Providencia, et sur 1 100 km de l'est à l'ouest, depuis l'Orénoque jusqu'au Pacifique. Il est partagé entre 5 grandes régions naturelles : la région andine (25 % de la superficie totale), la région côtière caraïbe (12 %), la bordure pacifique (6,5 %), les plaines orientales (Llanos) et l'Amazonie (56,5 %).
Dans la Colombie andine, le système montagneux
atteint sa plus grande largeur (450 km) avec ses trois grandes chaînes
plissées ou cordillères disposées du nord au sud en éventail à partir
des confins de l'Équateur. Leur brusque élévation au-dessus des plaines
qui les entourent et leur séparation par deux fossés d'effondrement
méridiens très profonds, occupés par le río Magdalena, le cours
supérieur du Patía et le Cauca, donnent une grande vigueur au relief et
sont à l'origine du compartimentage du pays. La Cordillère orientale, la
plus massive, s'élargit au centre (230 km au niveau de Tunja), puis se
divise en deux branches, l'une s'abaissant vers la péninsule de la
Guajira, l'autre se raccordant aux Andes vénézuéliennes. La vallée du Magdalena,
qui la sépare de la Cordillère centrale, est un fossé très profond
(500 m d'altitude à 150 km des sources) qui s'étire sur plus de
1 000 km. La Cordillère centrale est la plus élevée et la plus étroite
(80 km de largeur, aucun col à moins de 3 000 m d'altitude). Une suite
de grands volcans portant des neiges éternelles et des glaciers dominent
la chaîne. La cordillère s'achève au-dessus des plaines caraïbes par le
vaste plateau d'Antioquia, disséqué par l'érosion. Le fossé
d'effondrement Patía-Cauca sépare les Cordillères centrale et
occidentale. Long de 500 km, bien calibré (largeur moyenne 70 km),
remblayé d'alluvions fines, il est partagé en deux segments qui
s'inclinent vers le nord et vers le sud de 1 200 m à 800 m d'altitude.
La Cordillère occidentale est moins puissante, formée de chaînons
discontinus s'élevant, pour la plupart, entre 2 000 et 3 000 m, avec des
cols moins élevés.
L'étagement biogéographique caractéristique des
montagnes tropicales s'observe sur les versants : on distingue, depuis
la base, les terres chaudes (tierras calientes, 800-1 100 m d'altitude), les terres tempérées (tierras templadas, 1 100-2 500 m), les terres froides (tierras frias, 2 500-3 300 m) et les hauts sommets (páramos
au-dessus de 3 300 m). À cet étagement thermique se superpose une
pluviométrie contrastée qui oppose les Andes sèches aux Andes humides.
Celles-ci dessinent une bande orientée du S.-O. au N.-E., depuis le
versant pacifique de la Cordillère occidentale jusqu'au nord de la
Cordillère orientale, et reçoivent plus de 1 200 mm d'eau par an,
répartis entre deux saisons de pluies (inviernos), d'avril à juin puis d'octobre à décembre, entrecoupées de saisons sèches (veranos).
Les Andes sèches s'étendent dans la partie méridionale du système
montagneux et dans les vallées à l'abri des vents humides qui soufflent
du Pacifique ou de secteur est (alizés et trains de dépressions
originaires d'Amazonie) ; dans les zones les plus sèches, la
pluviométrie s'affaisse à 800 mm d'eau par an, et l'agriculture devient
aléatoire sans irrigation. À l'état naturel, divers types de forêts
s'étagent sur les flancs des Andes humides, depuis la forêt équatoriale
jusqu'à celle des conifères tempérés, qui précèdent les prairies
alpines ; il n'en reste plus que les vastes forêts denses du versant
pacifique de la Cordillère occidentale, les autres parties des Andes
humides étant densément occupées. Dans les Andes sèches, la végétation
naturelle consiste en des steppes buissonnantes et en des savanes plus
ou moins arborées ; elles ont été fréquemment modifiées par l'homme.
Cette variété des milieux biogéographiques permet une grande diversité
des cultures.
Les terres basses chaudes situées en dehors du
système andin occupent les trois quarts du territoire. Les plaines
côtières caraïbes, qui s'allongent sur 900 km, sont formées d'une
juxtaposition de plaines alluviales construites par les fleuves andins.
Elles sont accidentées par des collines de roches tertiaires ou de
petits reliefs de socle cristallin (péninsule de la Guajira). La côte
est basse ou à lagunes, sauf au pied du massif de Santa Marta. Celle-ci
porte le point culminant de Colombie (5 775 m). Dans cette région
caraïbe, la pluviométrie diminue du sud-ouest, qui reçoit d'abondantes
précipitations, vers le nord-est, où le climat devient semi-aride
(500 mm d'eau par an dans la Guajira), la sierra Nevada perturbant cette
répartition par le déclenchement d'abondantes précipitations
orographiques. La végétation naturelle passe donc de la forêt dense au
sud-ouest, aux savanes plus ou moins amphibies et arborées sur le bas
Magdalena et à la steppe à épineux au nord-est, le massif de Santa Marta
présentant un étagement biogéographique andin.
La région côtière du Pacifique est accidentée dans le
secteur où la serranía del Baudó atteint le rivage. Partout ailleurs,
elle est formée de deltas et de plaines alluviales très marécageux,
bordés de mangroves. Le climat étant pluvieux, la forêt dense prospère.
Les plaines orientales (environ 650 000 km2)
correspondent, au nord, à une partie de la région occidentale des
Llanos, ces savanes plus ou moins arborées et à forêts-galeries du
bassin de l'Orénoque, au sud, à un morceau de l'Amazonie forestière. Le
milieu naturel a été peu modifié, la colonisation agricole et la
prospection pétrolière n'ayant entamé que le piémont andin et les hautes
terrasses. Plus ouverts, les Llanos sont moins inhospitaliers que
l'Amazonie.
2. Une population métissée
À l'arrivée des conquérants espagnols, au xvie s.,
les hautes terres salubres de la région andine étaient occupées par une
importante population amérindienne, estimée à près d'un million
d'individus. Ces communautés indiennes ne représentent plus,
aujourd'hui, que 2 % de la population. En effet, 60 % des Colombiens
sont considérés comme métis, 20 % comme Blancs, alors que la population
noire, concentrée sur les côtes caraïbes, en représente 18 %. La
ségrégation raciale, si elle n'est pas officielle, est une réalité, les
minorités noire et indienne occupant, dans leur grande majorité, le bas
de l'échelle sociale. La Constitution de 1991 a pourtant reconnu leur
identité ethnique et leur a accordé des droits civiques, leur allouant
un nombre réduit de sièges au Congrès.

La Colombie a connu une véritable explosion
démographique au cours des cinq dernières décennies. Sa population est
passée de 8,7 millions d'habitants en 1938 à plus de 45 millions en
2009, soit une densité moyenne de 40 habitants par km2.
Celle-ci ne rend pas compte, toutefois, des profondes disparités
régionales. Les déséquilibres du peuplement et l'aspect fortement
compartimenté de l'espace colombien doivent autant aux contraintes du
milieu naturel qu'aux héritages d'une histoire fortement régionalisée.
L'essentiel de la croissance démographique s'est en effet opéré dans les
axes de colonisation espagnole (région andine et côtes caraïbes). À
cette Colombie « pleine » s'oppose la Colombie « vide » des régions
orientales (Llanos, Amazonie) et du littoral pacifique. L'urbanisation
progresse rapidement, 72 % de la population vivant désormais dans les
villes, notamment dans les quatre plus grandes métropoles du pays :
Bogotá, Medellín, Cali et Barranquilla.
La croissance de la population colombienne a
aujourd'hui considérablement ralenti, en raison d'une baisse de la
natalité. L'indice de fécondité est passé de 5,3 enfants par femme en
1970 à 2,4 et le taux d'accroissement naturel est estimé à 1,4 % par an,
contre 3 % entre 1960 et 1965. La population est encore très jeune :
29 % des Colombiens ont moins de 18 ans et 5 % seulement sont âgés de
plus de 65 ans. L'espérance de vie atteint 72 ans, mais la proportion
élevée de morts violentes (de l'ordre de 80 pour 100 000 habitants),
frappant surtout les hommes jeunes, a un impact significatif sur
l'espérance de vie de la population masculine.
3. L'essor économique
Le « triangle d'or » andin (Bogotá-Medellín-Cali) constitue le cœur économique d'un pays industrialisé et urbanisé, mais au sein duquel l'agriculture occupe toujours une place de choix. La Colombie est considérée comme l'une des puissances de l'Amérique latine. Mais cette Colombie moderne et dynamique couvre à peine la moitié du territoire national. Sur les côtes de l'Atlantique, le développement se polarise autour de la ville de Barranquilla, qui s'affirme comme un centre secondaire. La côte pacifique, extrêmement pauvre, comporte de vastes espaces vides. Dans la partie orientale, la forêt amazonienne est pratiquement inoccupée, tandis que les Llanos constituent le domaine des grandes propriétés d'élevage extensif. Sur ces territoires en marge, l'État est pratiquement absent. Région de colonisation et de production de drogue, les plaines ont été, pendant des décennies, le théâtre de la violence des guérillas, désormais présentes dans le centre économique du pays.3.1. Mines et pétrole
Le secteur minier ne représente que 5 % du produit intérieur brut (P.I.B.), mais ce pourcentage ne rend pas compte de l'importance du charbon et, surtout, du pétrole dans l'économie colombienne. La Colombie, qui exporte des hydrocarbures depuis 1980, est devenue le troisième pays producteur d'Amérique latine. La production se concentre dans les vallées du Magdalena, dans les plaines orientales (Llanos) et au nord-est, à la frontière avec le Venezuela. L'exploitation du gigantesque gisement de Cusiana, découvert en 1988, et de celui de Cupiagua, découvert en 1991, ont entraîné un accroissement de la production. La prospection, l'extraction, le transport et le raffinage sont aux mains de l'entreprise d'État « Empresa colombiana de petroleo » (ECOPETROL). Au cours des années 1980, la Colombie est également devenue le premier pays charbonnier d'Amérique latine grâce à la mine « à ciel ouvert » située à El Cerrejón, dans la presqu'île de la Guajira, dont la production a fortement augmenté ces dernières années. Cette production est exportée depuis le port minéralier de la baie de Portete. Ce gisement est complété par celui d'El Descanso. L'ensemble fait du pays le deuxième d'Amérique latine en ce qui concerne les réserves de charbon. La Colombie extrait aussi de l'or, du fer, du nickel (gisement de Cerro Matoso) et des émeraudes (un tiers de la production mondiale). La Colombie développe aussi son potentiel hydroélectrique.3.2. L'agriculture et l'élevage
Le secteur agricole, principale source de devises et
d'emplois (23 % de la population active), procure 12 % du P.I.B. Les
productions sont très variées en raison de la diversité des milieux
biogéographiques et des structures agraires. L'agriculture colombienne
présente une double dualité avec, d'une part, l'existence d'une
agriculture parallèle, illégale, fondée sur la production de cannabis et
de coca (la Colombie étant probablement, après le Pérou, le deuxième
producteur mondial de coca), et, d'autre part, la persistance de
structures foncières fortement inégalitaires, caractérisées par la
coexistence de petites exploitations agricoles (microfundia) pratiquant
une polyculture vivrière, et de grands domaines (latifundia) voués à
l'élevage bovin extensif ou aux cultures commerciales.

Le café constitue la première culture d'exportation, avec une production de 700 000 tonnes en 2006 (3e rang
mondial), répartie sur 1 million d'hectares plantés (17 % des surfaces
cultivées) situés, pour l'essentiel, au centre du pays, sur les versants
humides des cordillères andines (provinces d'Antioquia, du Caldas, du
Tolima et du Valle del Cauca). Viennent ensuite la banane et
l'horticulture, la Colombie étant le deuxième exportateur mondial de
fleurs coupées après les Pays-Bas. La production agricole destinée au
marché intérieur est dominée par le riz, le maïs, le manioc, la canne à
sucre, le cacao, la pomme de terre et le coton. Les cultures s'étagent
en fonction de l'altitude : canne à sucre, coton, cacao, banane dans les
fonds plats des vallées, café et cultures vivrières au-dessous de
2 000 m, céréales et élevage jusqu'à plus de 3 000 m.
3.3. Les industries
Les industries (employant 19 % de la population active) se concentrent autour des quatre métropoles millionnaires (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla) et fournissent environ 35 % du P.I.B. La principale branche d'activité est l'agroalimentaire ; la fabrication du café moulu représente, à elle seule, 25 % de la production industrielle. Deuxième grand secteur, l'industrie chimique (14 % de la production industrielle) est contrôlée par les grandes compagnies internationales ; fabriquant une gamme diversifiée de produits (cosmétiques, fertilisants, insecticides, produits pharmaceutiques…), c'est la branche industrielle qui a le plus bénéficié de la libéralisation de l'économie. Les autres secteurs importants sont l'industrie textile et la confection (3e rang national, 10 % de la production), concentrées principalement autour de Medellín, la métallurgie, la construction mécanique, la construction automobile et la filière bois. Plusieurs secteurs nouveaux sont en phase de croissance : les hautes technologies, le tourisme médical, les centres d'appels, les produits cosmétiques.3.4. Commerce extérieur
Principal partenaire économique, les États-Unis absorbent, en valeur, 30 % des exportations colombiennes. L'Union européenne occupe la deuxième place. La Colombie se place au quatrième rang pour les investissements directs étrangers en Amérique latine, après le Brésil, le Mexique et le Chili, devant l'Argentine. Les investissements directs étrangers sont passés de 2 milliards de dollars par an en 2002, année de l'élection d'Uribe, à 10 milliards de dollars par an en 2008.
En 2012, un accord de libre-échange, l'Alliance du
Pacifique, est ratifié entre la Colombie, le Chili, le Pérou et le
Mexique, le Costa Rica et le Panamá ayant un statut d'observateur.
HISTOIRE
1. La période coloniale
À leur arrivée en Colombie, les Espagnols ne trouvent pas de grands foyers culturels encore actifs, hormis celui des Muiscas (ou Chibchas) des hauts plateaux orientaux.
Darién, fondé en 1510 dans l'isthme, est le premier
établissement espagnol permanent du continent. On doit à Rodrigo de
Bastidas la fondation de Santa Marta, bientôt suivie de celle de
Cartagena par Pedro de Heredia. L'Eldorado attire ensuite des colons
vers l'intérieur : tandis que Nikolaus Federmann pénètre en 1536 dans
les plaines orientales, venant du Venezuela, et que Sebastián de
Belalcázar, venant de Quito, conquiert Popayán et arrive par le Cauca
jusqu'à Antioquia, Gonzalo Jiménez de Quesada remonte le cours de la Magdalena et fonde, le 6 août 1538, Santa Fe (→ Bogotá).
Jusqu'en 1541, l'occupation se développe ; les villes
se multiplient, mais, en raison de la difficulté des communications
jusqu'au début du xixe siècle, les centres de peuplement demeurent isolés les uns des autres, favorisant ainsi l'autonomie municipale.
1.1. La vice-royauté de Nouvelle-Grenade
Jusqu'en 1717, la Nouvelle-Grenade est rattachée à la vice-royauté de Lima. Après 1739, elle forme avec le Venezuela la vice-royauté de Nouvelle-Grenade, dont Bogotá, déjà siège d'une audiencia depuis 1549, devient la capitale.
Les Espagnols ne trouvent pas en Nouvelle-Grenade les
métaux précieux qu'ils espéraient : ils y exploitent cependant le sel
gemme et les émeraudes. Deux ressources assurent la prospérité de la
colonie. D'une part, les grands domaines sont mis en valeur grâce au
travail forcé des Indiens, bientôt relayés sur la côte nord par les
esclaves noirs. D'autre part, la présence de l'isthme assure aux ports
de Nouvelle-Grenade une richesse qui attire souvent les corsaires.
À Cartagena, à Nombre de Dios transitent les produits
du Pérou, du Mexique et même des Philippines, et les galions espagnols
alimentent chaque année la foire de Nombre de Dios. L'Église catholique
s'implante très tôt en Nouvelle-Grenade : Santa Marta a eu un évêque dès
1534, Bogotá un archevêque en 1573, et l'évangélisation a été très
active. Dotée de domaines importants, l'Église assure d'autre part, pour
des siècles, l'enseignement (une université fonctionne dès le xvie siècle à Bogotá). Les langues indigènes reculent alors rapidement devant l'espagnol. La vie intellectuelle est florissante, et la société créole produit, au xviiie siècle, de grands savants, tels les naturalistes José Celestino Mutis (1732-1808) et Francisco José de Caldas (1768-1816).
2. L'indépendance (1810-1815)
2.1. L'insurrection pour l'indépendance : Simón Bolívar
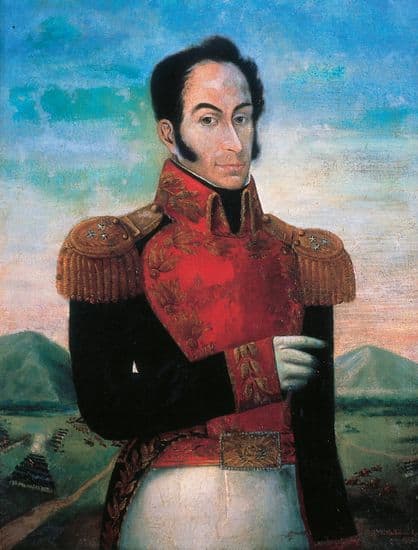
L'occupation napoléonienne en Espagne stimule le
désir d'indépendance. Une junte est constituée à Bogotá le 20 juillet
1810 : elle aboutit, un an plus tard, à la proclamation d'une fédération
des provinces de la Nouvelle-Grenade, qui rompent avec la métropole. La
répression espagnole, conduite par le général Morillo, est
particulièrement sanglante : Cartagena est reprise en 1815, et toute
résistance disparaît en 1817.
Cette violence même, l'action de Bolívar et de ses lieutenants José Antonio Páez et Francisco de Paula Santander relancent l'insurrection, qui triomphe grâce aux victoires de Boyacá (1819), Carabobo (1821) et Pichincha (1822).
Le 10 août 1819, Bolívar proclame l'union du
Venezuela et de la Nouvelle-Grenade. Le congrès d'Angostura (17 décembre
1819) aboutit ainsi à la constitution d'une république de
Grande-Colombie, à laquelle s'intègrent Panama en 1821 et l'Équateur en
1822. Cette union ne survit pas à Bolívar : en 1830, le Venezuela, puis
l'Équateur font sécession.
2.2. Libéraux et conservateurs au pouvoir : un siècle d'instabilité
Dès cette époque apparaissent les deux grands partis qui vont désormais dominer la politique du pays : celui des conservateurs centralistes, qui s'appuient sur l'Église catholique, le catholicisme étant religion d'État, et celui des libéraux fédéralistes, qui veulent réduire l'influence aussi bien économique que spirituelle de celle-ci.
Les conservateurs dotent d'abord la République de
Nouvelle-Grenade d'une Constitution unitaire. Mais, à partir de 1845,
les libéraux – avec les présidents Mosquera, López (1849) et surtout
Obando (1853) – tentent de faire triompher leurs conceptions
fédéralistes : ils provoquent la guerre civile et, en 1854, s'installe
la dictature de Melo. Mais des conservateurs modérés reviennent au
pouvoir, et l'un d'eux, le président Ospina Rodriguez (1857), fait
adopter, en mai 1858, une Constitution semi-fédérale pour la
« Confédération grenadine ».
En 1861, le libéral Tomás Cipriano Mosquera revient
au pouvoir en renversant le gouvernement et s'en prend à l'Église
(expulsion des jésuites, saisie des biens). Une nouvelle Constitution,
nettement fédéraliste, réalise les « États-Unis de Colombie » (1863).
Réélu en 1866, Mosquera est renversé en 1867 par des libéraux radicaux.
Après une nouvelle guerre civile en 1876, les
conservateurs reviennent au pouvoir en 1880 avec le libéral dissident
Rafael Núñez, qui s'appuie sur le clergé et les grands propriétaires :
l'État prend alors le nom de République de Colombie, avec une
Constitution centraliste (1886). Les libéraux, fédéralistes, se
soulèveront à plusieurs reprises (insurrections de 1885 et de 1895, et
surtout « guerre des Mille Jours » [1889-1903]).
Cette instabilité, durant tout le xixe siècle,
est due en grande partie à l'insuffisance des voies de communication,
qui favorise le maintien des particularismes locaux et freine
l'évolution de l'économie.
3. Une démocratie en proie à la violence
3.1. Stabilité politique et expansion économique (1903-1930)
En 1903, avec l'accession de Panama à l'indépendance, favorisée par Washington, le pays doit abandonner tout espoir de contrôle du commerce interocéanique. Mais l'indemnisation versée par les États-Unis sera un facteur d'expansion. À partir du gouvernement du général Rafael Rayes (1904-1909), le pays rentre dans une ère de stabilité politique qui fait passer au premier plan les problèmes économiques. Sous les présidences des conservateurs Nel Ospina (1922) et Abadía Méndez (1926), des emprunts américains permettent la construction de routes, tandis que, dès 1919, apparaît l'aviation commerciale.
En contrepartie, cependant, l'influence économique
des États-Unis ne cesse de grandir. Les Américains contrôlent le marché
du café, l'exploitation (depuis 1925) du pétrole et les plantations de
bananiers.
3.2. De la crise à la guerre civile
Dans les années 1929-1930, la Colombie est confrontée à une double crise : la dépression mondiale d'un côté, la superproduction de café brésilien de l'autre, avec la baisse des cours qu'elle entraîne. Les conflits agraires revêtent sans cesse plus d'ampleur et menacent la production dans certaines régions. Syndicats et ligues paysannes se multiplient.
Élu en 1934, le libéral Alfonso López Pumarejo
procède à des réformes sociales (loi sur la journée de travail de
8 heures, projet de réforme agraire). Il inquiète l'aile droite
libérale, qui fait élire Eduardo Santos en 1938. Revenu au pouvoir en
1942, A. López est contraint de démissionner trois ans plus tard.
Alberto Lleras Camargo, qui le remplace à la tête de l'État, entreprend
alors une politique d'union nationale groupant libéraux et
conservateurs ; il provoque l'opposition de l'aile gauche libérale, qui
se radicalise sous l'influence de l'avocat marxiste Jorge Eliecer
Gaitán.
En 1946, c'est un conservateur, Mariano Ospina Pérez,
qui revient au pouvoir. L'assassinat, le 9 avril 1948, de Gaitán, dont
la popularité n'a cessé de grandir auprès des masses, déclenche des
émeutes sanglantes dans la capitale (le bogotazo) et dans les
grandes villes. Ces révoltes, suivies d'une violente répression, ouvrent
une période de guerre civile larvée d'une cruauté extrême (la violencia) et dont le nombre de victimes est estimé entre 200 000 et 300 000 morts.
3.3. Le Front national
L'expérience de la violencia et le développement d'une guérilla autonome amènent au pouvoir un militaire, le général Rojas Pinilla. Hormis cette courte dictature militaire (1953-1957), la Colombie est l'un des rares pays de l'Amérique latine à avoir conservé, tout au long de ce siècle, un régime politique de démocratie civile. Elle est toutefois l'un des seuls pays de cette zone où la violence et les conflits armés soient aussi constants. La démocratie civile a pu être assurée par un pacte entre libéraux et conservateurs (le Front national), qui a permis une accalmie sur le plan politique.
En 1957, une réforme constitutionnelle instaure pour
une durée de seize ans une alternance des deux partis à la présidence,
une répartition équitable des postes gouvernementaux et une
représentation égale au Congrès. Le retour à des élections
présidentielles libres en 1974 n'a pas empêché que la formule du partage
soit strictement appliquée pour toutes les charges politiques et
administratives. Depuis lors, le parti libéral tend à être le parti du
gouvernement.
En 1982, à la suite de dissensions internes au sein du parti libéral, c'est un conservateur, Belisario Betancur,
qui est élu de peu à la présidence, mais ses trois successeurs,
Virgilio Barco Vargas, César Gaviria Trujillo et Ernesto Samper, sont
des libéraux.
3.4. Les guérillas
Si la démocratie civile a pu être assurée par le Front national, la violence, quant à elle, n'a pas cessé depuis la guerre civile de 1948-1953. En effet, au moins la moitié des combattants n'a pas déposé les armes.
Dans les années 1960, des groupes d'autodéfense
paysanne contrôlés par le parti communiste, fondé en 1930, donnent
naissance aux Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), d'influence castriste.
À la même époque apparaît l'Armée de libération
nationale (ELN). Durant les années 1970 naît une guérilla urbaine, le
Mouvement du 19 avril (M-19) ; celui-ci, qui réussit des actions
spectaculaires (vol de plusieurs milliers d'armes dans une caserne en
1979, prise d'otages à l'ambassade de la République dominicaine en 1980,
prise d'otages sanglante dans le palais de justice de Bogotá en 1985),
est l'un des groupes de guérilla les plus populaires d'Amérique latine.
Entre 1987 et 1997, l'ELN et les FARC multiplient les
enlèvements. Elles font de cette pratique leur deuxième source de
financement et un moyen de pression sur les autorités locales.
Soupçonnées d'être impliquées dans le trafic de drogue au milieu des
années 1980, ces guérillas abandonnent les zones rurales et se
concentrent dans les régions économiquement riches (celles de production
de biens d'exportation et d'exploitation minière).
Parallèlement, à partir des années 1980, des groupes
paramilitaires se constituent et prolifèrent ; ils comptent sur le
soutien de l'armée et des grands propriétaires, mais disposent d'un haut
degré d'autonomie. Les paramilitaires sont également suspectés d'être
le bras armé des narcotrafiquants. La Colombie devient à nouveau le
théâtre d'une violence exceptionnelle. Massacres, exactions,
enlèvements, rackets – de la part des paramilitaires comme des
guérilleros – affectent une population civile soumise à la loi du
silence. Plus de 500 000 personnes ont dû abandonner leur région
d'origine. Dans ce contexte, des arrangements politiques ne semblent pas
constituer une véritable solution au problème.
3.5. La lutte contre le trafic de drogue
Des négociations sérieuses ont pourtant été entamées sous la présidence de B. Betancur (1982-1986), puis sous celle de Virgilio Barco Vargas (1986-1990), mais les cessez-le-feu n'ont été que rarement respectés. Sous la présidence de C. Gaviria Trujillo (1990-1994), des perspectives de paix avec la guérilla se font jour : le M-19, ayant accepté de déposer les armes et de participer au jeu démocratique, siège à l'Assemblée constituante de 1991 puis au Congrès. Certaines guérillas sont également démobilisées, et deux grands narcotrafiquants, Fabio Vásquez et Pablo Escobar, se rendent à la justice.
En 1992, l'Action démocratique, émanation politique
du M-19, quitte la coalition gouvernementale tandis que des guérillas,
même affaiblies, poursuivent leurs actions terroristes. La priorité est
pourtant donnée à la lutte contre le trafic de drogue. En 1993, à la
suite d'une évasion, Pablo Escobar est tué par les forces de sécurité.
Après l'accession à la présidence d'Ernesto Samper, en 1994,
l'arrestation de plusieurs lieutenants d'Escobar semble représenter une
victoire du pouvoir central sur le narcotrafic. Peu après cependant, les
membres du parti libéral sont accusés d'avoir reçu, lors de la campagne
électorale, le soutien financier des trafiquants de drogue de Cali.
Afin de restaurer sa crédibilité, E. Samper nomme le
général Rosso Cadena à la tête d'une opération antidrogue, qui élimine
huit des principales têtes du cartel de Cali. Mais le succès de ces
opérations est éclipsé par les résultats des enquêtes réalisées sur
l'infiltration de l'argent de la drogue dans la vie politique
colombienne, donnant lieu à plusieurs scandales politiques et
compromettant gravement E. Samper. Si celui-ci a pu mener à terme son
mandat présidentiel, les sanctions économiques imposées par les
États-Unis l'ont obligé à renforcer son action contre le narcotrafic. En
1996, le gouvernement fait voter par le Congrès une loi sur la
confiscation des biens des barons de la drogue. En 1997, un projet sur
la réintroduction d'un traité prévoyant l'extradition vers les
États-Unis des grands chefs du narcotrafic est également approuvé.
La politique de E. Samper est toutefois largement
désavouée par l'élection d'Andrés Pastrana Arango à la présidence de la
République, en juin 1998, élection qui marque le retour au pouvoir du
parti conservateur.
3.6. L'échec des efforts de paix
Fidèle à ses promesses de campagne, le nouveau dirigeant colombien engage des pourparlers de paix difficiles en particulier avec les FARC. Dès novembre 1998, ce mouvement de guérilla obtient du gouvernement le contrôle administratif d'une zone démilitarisée de 42 000 km2 dans le sud-ouest du pays. L'attribution d'une deuxième zone démilitarisée (5 000 km2 environ) dans le nord à l'ELN – aux pouvoirs cependant moins étendus que ceux des FARC –, en échange de l'ouverture des négociations, est annoncée en avril 2000, mais finalement repoussée sine die devant le tollé suscité au sein des populations concernées.
Ces concessions accordées aux guérillas provoquent la
colère des mouvements paramilitaires, qui se sentent marginalisés.
Pourtant le plan de paix cher au président Pastrana – destiné à lutter
contre le trafic de drogue et à mettre fin à la violence armée –
progresse ; en juillet 2000, les États-Unis décident d'octroyer une aide
exceptionnelle de 1,3 milliard de dollars pour son financement.
Après une interruption entre novembre 2000 et février
2001 – les FARC exigeant du gouvernement qu'une véritable lutte soit
menée contre les paramilitaires –, les négociations de paix reprennent,
même si le rang de leurs détracteurs est en constante augmentation. En
effet, le processus a perdu au fil des mois de sa crédibilité ; les
critiques portent surtout sur la zone octroyée à la guérilla, qui serait
utilisée à des fins criminelles (développement de la culture de la
coca ; séquestration de civils pris en otage contre rançon).
Fin 2001, le contexte international, avec le lancement par les Américains de la campagne antiterroriste au lendemain des attentats de septembre 2001
aux États-Unis, n'est guère favorable à une reprise sérieuse du
dialogue avec des organisations, qualifiées de terroristes par
Washington (ainsi sont classées les FARC, l'ELN, mais aussi le principal
groupe de paramilitaires d'extrême droite, les AUC). En octobre, la
zone octroyée aux FARC est cependant reconduite pour trois mois. Le
processus moribond connaît encore quelques ultimes coups de théâtre
avant d'être enterré par son initiateur le 20 février 2002.
Au cours d'une campagne électorale rythmée par son
lot d'assassinats et d'enlèvements (celui, notamment, de la candidate
des Verts à la présidentielle de mai 2002, la Franco-Colombienne Íngrid Betancourt,
par les FARC le 23 février), un candidat indépendant, dissident du
parti libéral, Álvaro Uribe Vélez, partisan d'une politique de fermeté,
se détache face aux candidats des partis libéral et conservateur,
victimes d'une défiance grandissante de leur électorat. Le 26 mai,
Álvaro Uribe Vélez est élu, dès le premier tour, président de la
République (53 %), devant son principal adversaire, Horacio Serpa, du
parti libéral (31 %). Outre le rétablissement de l'autorité de l'État
par la mise au pas des guérillas, le nouveau président promet une lutte
sans merci contre la corruption et une ample réforme politique.
3.7. Álvaro Uribe Vélez : entre austérité et fermeté
Conformément à ses promesses de campagne, Álvaro Uribe Vélez fait montre d'autorité en déclarant d'emblée l'état d'exception, en mettant en place un réseau d'informateurs civils tout en cherchant à relancer les pourparlers de paix sous les auspices des Nations unies. En juin 2003, il engage le dialogue avec l'ELN en vue d'un éventuel processus de paix ; ce dernier, après avoir échoué malgré une tentative de médiation mexicaine, est relancé en 2005 à La Havane pour être interrompu en 2006 par la reprise des rivalités entre ELN et FARC. Les deux guérillas, affaiblies par l'offensive menée par l'armée colombienne depuis 2004 et opposées sur le principe même d'un dialogue avec le gouvernement, se livrent une guerre ouverte en Arauca, proche du Venezuela et riche en pétrole.
Le président engage également en juillet 2003 de
difficiles négociations avec le mouvement paramilitaire d'extrême droite
AUC en vue de sa totale démobilisation prévue pour 2005. À cet effet,
la loi « Justice et Paix » adoptée par le Congrès en juillet 2005 – et
applicable tant aux groupes paramillitaires qu'aux guérillas – définit
les mesures de réinsertion prévues pour les repentis et le cadre légal
dans lequel victimes et survivants peuvent espérer obtenir justice,
vérité et réparation. Le désarmement de 31 000 combattants des AUC
s'achève officiellement en avril 2005. Cependant, le processus de
réconciliation suscite le scepticisme de l'Église catholique et d'une
partie de l'élite politique économique du pays, qui estiment que la
politique du gouvernement ne diminue pas le pouvoir des paramilitaires
mais en change la nature. Les organisations internationales dénoncent
l'ambiguïté de cette politique. Enfin, les révélations par les chefs
paramilitaires concernant les complicités dont ils ont bénéficié au sein
de la classe politique (scandale de la « para-politique »), de l'armée
et de l'État, éclaboussent l'entourage du président.
Partisan de la plus grande fermeté vis-à-vis des
FARC, le président Uribe lance début 2004 avec l'appui des États-Unis le
plan « Patriote », la plus grande opération militaire contre la
guérilla. Surmontant sa réticence à négocier avec une organisation
terroriste, et à l'écoute d'une majorité de Colombiens désormais
favorables à un accord humanitaire pour obtenir la libération des
otages, le président consent à libérer, en décembre 2004, 23 guérilleros
dans l'espoir que les FARC acceptent, en retour, de libérer leurs
otages (59 « prisonniers politiques »). Mais, en février 2005, une vague
d'attaques menées par la guérilla porte un sérieux démenti au discours
politique du président, qui persiste à nier l'existence d'un conflit
armé. En janvier 2006 enfin, les FARC opposent une fin de non-recevoir
aux propositions du gouvernement de créer une zone démilitarisée sous
contrôle international dans le sud-ouest du pays afin de négocier un
échange humanitaire.
Fort du relatif succès de sa politique dite de
« sécurité démocratique », à l'origine de la baisse des attentats et des
enlèvements, et, par ailleurs, d'une reprise économique sensible, le
président Uribe – autorisé à briguer un second mandat à la tête de
l'État depuis la validation d'un amendement constitutionnel en octobre
2005 – est réélu au premier tour de l'élection présidentielle du 28 mai
2006 avec 62,2 % des suffrages. Il devance largement Carlos Gaviria
Díaz, le candidat de la gauche réunie autour du Pôle démocratique
alternatif (PDA), qui, en recueillant 22 % des suffrages, devient la
première force d'opposition. La défaite cinglante du libéral Horacio
Serpa (11,84 %), candidat pour la troisième fois consécutive, relègue le
parti libéral, longtemps majoritaire et au pouvoir, au rang de force de
soutien à l'opposition.
La victoire du président Uribe confirme – au sein d'une Amérique latine
basculant à gauche – l'ancrage de la Colombie à droite et son
alignement sur les États-Unis, dont elle est le principal allié dans la
région et le troisième bénéficiaire de l'aide extérieure. En 2006, un
accord de libre-échange est signé avec Washington, malgré l'opposition
populaire colombienne. Participant au processus d'intégration régionale,
Bogotá, déjà membre de la Communauté andine des nations (CAN) et de l'ALADI, devient, en 2004, membre associé du Mercosur.
En 2006 et 2007, les négociations informelles entre
le pouvoir et les FARC piétinent, la guérilla exigeant la création d'une
zone démilitarisée dans le sud-ouest du pays avant tout échange de
prisonniers. Malgré la détérioration des relations entre le président
Uribe et son homologue vénézuélien, Hugo Chávez,
la médiation de ce dernier permet dans un premier temps la libération
de plusieurs otages (janvier 2008) mais, alors que les FARC perdent
successivement leur numéro 2, Raúl Reyes, dans une attaque de l'armée
(mars) puis leur chef historique, Manuel Marulanda, des suites d'une
maladie, la politique de fermeté du gouvernement est finalement
couronnée de succès avec la libération en juillet, à l'issue d'une
opération militaire menée sans effusion de sang, de quinze prisonniers,
dont Í. Betancourt.
Par ailleurs, la coopération avec les États-Unis est
renforcée avec la mise à disposition de sept bases militaires dans le
cadre d'opérations contre le trafic de stupéfiants et la guérilla,
projet d'accord qui provoque de vives tensions au sein de l'Union des
nations sud américaines (UNASUR, fondée en mai 2008) avec le Venezuela
(et ses alliés équatorien et bolivien), un différend que les
participants au sommet latino-américain de Cancún en février 2010,
tentent d’aplanir.
Bien que mis en cause dans un scandale d'écoutes
illégales menées par les services de renseignement et accusé par
l'opposition d'avoir marchandé le soutien de certains parlementaires en
vue d'obtenir une majorité, Uribe reçoit en août et septembre 2009
l'aval du Sénat puis de la Chambre des représentants pour organiser un
référendum en vue de briguer un troisième mandat en mai 2010 – une loi
qui est toutefois censurée par la Cour constitutionnelle en février
2010. Le président s’incline alors devant cette décision. Mais,
démentant les pronostics, son camp – le parti social de l’Unité
nationale (ou « parti de la U ») et son allié, le parti
conservateur– renforce sensiblement ses positions aux élections
législatives de mars qui sont entachées de plusieurs irrégularités
(achats de votes notamment). Plusieurs candidats, impliqués dans le
scandale de la « para-politique » et sous le coup d’enquêtes
préliminaires diligentées par la Cour suprême, sont réélus, certains
d’entre eux sous la bannière d’un nouveau parti politique, le parti
d’Intégration nationale (PIN). Le 20 juin, Juan Manuel Santos, ancien
ministre de la Défense d'Uribe l’emporte au second tour de l’élection
présidentielle avec plus de 69 % des voix face au candidat écologiste
Antanas Mockus.
3.8. Juan Manuel Santos : continuité et rupture
S’il ne fait pas partie des dauphins d’Álvaro Uribe, le nouveau président porte l’héritage de la politique de son prédécesseur, notamment par sa participation en première ligne à la politique de sécurité mise en œuvre dans les années 2006-2009. Prônant ainsi la même fermeté, Juan Manuel Santos exige la libération de l’ensemble des otages avant toute négociation avec les FARC, qui, elles, ont proposé une reprise des discussions. La guérilla essuie d’importants revers : en septembre 2010, elle perd le chef de son aile militaire, Víctor Julio Suárez Rojas, alias le « Mono Jojoy », tué dans un bombardement. En novembre 2011, son chef politique et commandant suprême, Alfonso Cano, est également éliminé par l’armée à l’issue d’une vaste opération militaire, dans des circonstances controversées. Le mouvement est indéniablement affaibli : même si le nombre de ses attaques augmente (autour de 2 000 en 2010 et en 2011), ses actions sont plus dispersées et le fait de petits groupes réduits à quelques hommes.
Après le rétablissement de relations diplomatiques
avec le Venezuela rompues en juillet 2010, l’adoption de la loi sur
l’indemnisation des victimes et la restitution des terres aux personnes
déplacées (juin 2011) marque une rupture importante avec la politique
précédente ; elle implique en effet la reconnaissance de l’existence
d’un conflit armé, ce que A. Uribe avait toujours refusé réduisant ce
dernier à une « menace terroriste ».
Alors que les derniers otages « politiques » – dix
membres des forces de l’ordre – sont libérés en avril 2012, le
gouvernement relance des discussions avec la guérilla sur de nouvelles
bases. Rendues publiques en août, ces négociations de paix globales
s'ouvrent à Oslo en octobre et reprennent à La Havane à partir du mois
suivant. Elles portent sur cinq principaux points : développement rural
et accession à la terre ; fin des combats ; participation à la vie
politique et réintégration des guérilleros ; lutte contre le
narcotrafic ; droits des victimes. Les hostilités ne cessent pas pour
autant, hormis une courte trêve unilatérale de la guérilla entre
novembre 2012 et janvier 2013.
Si les délais annoncés pour la finalisation d’un
accord avant la fin de 2013 ne sont pas tenus, les négociations de paix,
confidentielles, se poursuivent au cours d’une série de cycles. En mai
2013, les parties parviennent à un accord sur la question de la réforme
agraire avant d’aborder au cours de l’été celle de la participation
politique. Après une nouvelle trêve unilatérale annoncée par les FARC en
décembre, le problème du trafic et de la culture des produits
stupéfiants (feuille de coca, pavot et marijuana) commence à être
discuté.
La poursuite de ces pourparlers est l’un des
principaux thèmes de la campagne électorale en vue des élections
nationales de mars et juin 2014. Les enquêtes d’opinion tendent à
montrer que dans leur majorité, les Colombiens y sont favorables tout en
restant sceptiques quant à leur issue. Davantage inquiétés par
l’insécurité urbaine, le chômage et la corruption, ils ne placent
cependant plus le conflit armé au premier plan de leurs préoccupations.
Depuis janvier 2013, les partisans d’Álvaro Uribe,
les plus critiques à l’égard du processus de paix et particulièrement
hostiles à l’idée d’amnistie, sont représentés au sein du Centre
démocratique. Rassemblant des dissidents issus pour la plupart du
« parti de la U », ce courant « uribiste » enregistre de bons résultats
aux élections législatives, parvenant à se hisser à la deuxième place au
Sénat (où est élu l’ex-président) et à la quatrième à la Chambre des
représentants.
Fort de ce premier succès, leur candidat Oscar Ivan
Zuluaga arrive en tête du premier tour du scrutin présidentiel (29,2 %)
devant le président sortant (25,6 %), la candidate du parti conservateur
(15,5 %), celle de l’opposition de gauche menée par le « Pôle
démocratique » (15,2 %) et le candidat écologiste (8,2 %).
À l’issue d’un âpre duel marqué par des accusations
mutuelles de corruption, J. M. Santos l’emporte de justesse le 15 juin
avec près de 51 % des suffrages contre 45 % à O. I. Zuluaga, le vote
blanc atteignant 4 %. Appuyé par le « parti de la U » et les libéraux,
le président bénéficie également du report précieux des voix de gauche,
alors que son adversaire a reçu le soutien du parti conservateur.
Présentée comme un plébiscite en faveur de la paix, cette réélection ne
mobilise toutefois qu’environ 48 % des électeurs malgré une campagne en
faveur de la participation.

0 commentaires:
Enregistrer un commentaire